De plus en plus de jeunes s’identifient aux minorités sexuelles, un élargissement qui s’inscrit dans la remise en question de l’hétéronormativité. Retour sur les nouveaux résultats de l’enquête sur la vie affective des jeunes adultes (ENVIE) menée par l’Institut national d’études démographiques (Ined), et dévoilés fin avril.
Se dire autrement. Première enquête démographique française dédiée entièrement aux relations intimes des jeunes, ENVIE a étudié les réponses de plus de 10 000 personnes âgées de 18 à 29 ans. Résultats : une femme sur cinq ne s’identifie pas comme hétérosexuelle, une proportion qui a d’ailleurs été multipliée par cinq depuis l’enquête Virage menée par l’Ined en 2015. Cette tendance se retrouve aussi du côté des hommes, mais de façon moins marquée. En effet, 8 % d’entre eux ne se définissent pas comme tel, soit 4 fois plus qu’avant.
Évolution majeure des minorités sexuelles
En parallèle, les jeunes se reconnaissent de plus en plus dans d’autres identifications comme la bisexualité, l’homosexualité ou la pansexualité, qui désigne le fait d’être attiré indépendamment du genre de la personne. L’appartenance aux minorités sexuelles semble donc se développer, et ce, principalement chez les femmes : 14 % d’entre elles se disent bisexuelles ou pansexuelles contre 4 % des hommes.
Ces résultats sont cohérents avec ceux de Contexte des sexualités en France publiés quelques mois plus tôt par l’Inserm. Côté acceptation de la pluralité sexuelle et de genre, 69,6 % des femmes de 18 à 89 ans considèrent que l’homosexualité est une sexualité comme les autres, contre 56,2 % des hommes, toujours un petit peu plus en marge. La transidentité demeure malheureusement toujours stigmatisée.
Des résultats qui prennent racine dans le contexte #MeToo
Cet élargissement des possibles sexuels révélé par ENVIE s’inscrit aussi dans la remise en question de l’hétéronormativité. Selon le chercheur Wilfried Rault, co-auteur de l’enquête, cela témoigne « d’une forte réflexivité des jeunes d’aujourd’hui sur le genre et les sexualités ». D’ailleurs, 1,7 % des jeunes sont non binaires et ne s’identifient ni comme homme ni comme femme.
Si les travaux de l’Ined ne peuvent établir de lien direct avec le mouvement #MeToo, ce phénomène reste une réponse probable aux nouvelles identifications. Parmi les répondantes, plusieurs ont vécu leur adolescence pendant la montée de dénonciation des violences sexistes et sexuelles. Véritable impact sur les choix de relations et de partenaires, ou facilité à le dire plus qu’avant ? Une tendance se dégage en tout cas : se dire hétérosexuel est de moins en moins la norme.
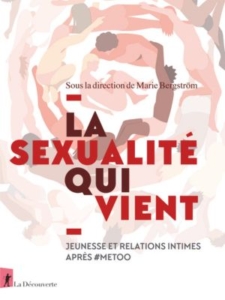 Le livre La sexualité qui vient, Jeunesse et relations intimes après #MeToo, dirigé par la sociologue Marie Bergström, s’appuie sur les résultats de l’enquête ENVIE, réalisée par l’Ined entre novembre 2022 et juillet 2023. Il livre un regard neuf sur l’évolution des relations intimes dans la société française actuelle.
Le livre La sexualité qui vient, Jeunesse et relations intimes après #MeToo, dirigé par la sociologue Marie Bergström, s’appuie sur les résultats de l’enquête ENVIE, réalisée par l’Ined entre novembre 2022 et juillet 2023. Il livre un regard neuf sur l’évolution des relations intimes dans la société française actuelle.
Par Cléo Derwel
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry


