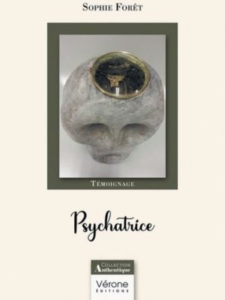Sophie Forêt a souffert de troubles mentaux et a eu un parcours complexe à travers différentes institutions psychiatriques. Elle a témoigné de son histoire dans le livre Psychatrice, qui illustre les défaillances de sa prise en charge.
Vocation Santé : Pour quelles raisons avez-vous avez écrit ce livre ?
Sophie Forêt : Écrire était une manière d’essayer de métaboliser certaines parties de ma vie, notamment mes séjours en institution psychiatrique. Je garde une grande colère par rapport à ce que j’y ai vécu, notamment une expérience très jeune en Belgique, mais surtout une autre que j’ai eu en France en 2018. Dans la vie de tous les jours, il est difficile d’analyser un parcours complexe de la sorte et de trouver l’occasion d’en parler suffisamment pour pouvoir l’approfondir.
Pourquoi avez-vous été internée ?
J’ai eu deux grands épisodes de maladie, un autour de mes 20 ans et l’autre autour de 30 ans, avec des symptômes très différents. Le premier s’est manifesté par un immense désespoir, où la seule issue me semblait être ma disparition. Le diagnostic qui a accompagné cela a été une « dépression profonde anxiogène ». Le second s’est manifesté par une bouffée délirante aiguë. Cette fois-là, on était plutôt du côté de ce qu’on appelle une psychose. Néanmoins, j’ai toujours refusé de penser qu’une maladie précise me collerait à la peau. Pour moi, ils ont été des réactions vives à des éléments de vie personnelle et je pense pouvoir dire aujourd’hui qu’avec attention et précaution, je ne devrais plus avoir affaire à ces manifestations psychiques.
Qu’avez-vous trouvé le plus difficile à vivre dans certains établissements et leurs prises en charge ?
Être enfermée pendant longtemps peut être très difficile à vivre, en particulier lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation sous contrainte, non issue d’une démarche volontaire. Lorsque les établissements ne donnent pas accès à un espace extérieur, à part une cour centrale, et prévoient peu ou pas de sorties, cela renforce le mal-être lié à l’enfermement. Il est très important de repenser l’extérieur, d’aménager les espaces pour que les patients puissent respirer. De plus, dans certains établissements, il y a peu ou pas d’activités, et celles-ci ne sont pas vraiment adaptées aux patients. Laisser des personnes enfermées pendant une longue période à ne rien faire va à contre-courant de leur évolution vers un mieux-être. Ainsi, nous ne sommes généralement pas préparés à la sortie d’hospitalisation, qui peut se révéler très compliqué, car nous avons été coupés du monde pendant longtemps et être identifié comme malade mental est associé à une honte et une stigmatisation.
Comment s’est passée votre sortie ?
Je suis sortie de ma première hospitalisation en allant moins bien qu’à mon arrivée. Bien entendu, cela est lié à un problème économique : beaucoup d’établissements manquent de moyens et de personnel pour déployer des approches plus intégratives et empathiques de la personne souffrante ; mais également systémique : une forme de maladie pose une étiquette sur une personne, avec un traitement correspondant, alors que c’est beaucoup plus complexe. Le discours général stigmatise, une personne qui a eu un problème psychiatrique est malade à vie, il n’y a pas de guérison possible… Les cours de psychologie dans le cursus général de médecine sont très légers et les approches enseignées sont principalement la thérapie par la médication.
À l’inverse, quelles sont les prises en charge que vous avez trouvé constructives ?
Lorsque nous sommes atteints d’un problème psychique, nous quittons en quelques sortes la « culture commune ». L’enjeu pour une bonne institution est d’arriver à maintenir ou rétablir le lien avec celle-ci. Ma seconde hospitalisation s’est beaucoup mieux passée, notamment grâce à de nombreuses activités enrichissantes qui y étaient mises en place : il y avait un calendrier hebdomadaire pour s’inscrire aux activités dans la semaine, comme faire du yoga, aller à la piscine, marcher en forêt, visiter une exposition… il y avait aussi une intervenante formidable, une artiste avec qui il était possible de faire différentes activités de manière très libre, comme de la sculpture ou de la peinture. Dans cet établissement, le personnel soignant avait beaucoup plus de disponibilités, il était possible d’avoir plusieurs créneaux assez longs de discussion chaque semaine avec une bonne écoute. Cela m’a largement aidé à me remettre de ma première grande dépression, étant donné que j’ai pu reprendre une vie étudiante sereine.
Comment êtes-vous suivie aujourd’hui ?
Depuis que je suis sortie d’hospitalisation psychiatrique en 2018, je suis en reconstruction permanente.
J’ai eu la chance d’avoir été mise en contact avec un psychiatre formidable qui me suit depuis plus de 6 ans. Il m’a beaucoup aidée à traverser ce que j’avais à traverser, et ce sans me prescrire de médicaments à outrance, juste de manière minutieuse, de temps en temps, par petites doses, et sans jamais me les imposer. J’ai beaucoup de chance d’avoir trouvé quelqu’un avec qui ça marche et où la parole est au centre de l’accompagnement.
Quelles sont les ressources que vous conseillez pour des personnes vivant des difficultés psychiques ?
Depuis quelques années, j’ai découvert une association internationale qui s’appelle le Réseau des entendeurs de voix, qui m’aide beaucoup. Il s’agit d’échanges entre personnes ayant eu des expériences d’entente de voix, qui sont d’ailleurs plus nombreuses que ce que l’on peut penser, et qui ne sont pas toutes considérées comme des personnes avec des problèmes psychiatriques. Il est possible d’y échanger sur ses expériences, les décortiquer, les analyser, dans un cadre de partage bienveillant. Des psychothérapeutes font aussi partie de cette association, ce qui leur permettent d’enrichir leurs approches. Quelques établissements commencent à intégrer le système de pairs-aidants, où d’anciens malades interviennent au sein des institutions pour partager leurs expériences et aider avec une bonne compréhension et légitimité. C’est une très bonne initiative, mais qui reste encore assez rare, notamment car ces interventions sont généralement bénévoles. Ces ressources sont précieuses et il ne faut pas hésiter à se renseigner et se tourner vers elles. Et dans les périodes difficiles, ne pas oublier de lever la tête pour regarder le ciel et la cime des arbres.
Par Antonin Counillon
Psychatrice
Le livre Psychatrice de Sophie Forêt, paru en mars 2024 aux éditions Vérone.
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry