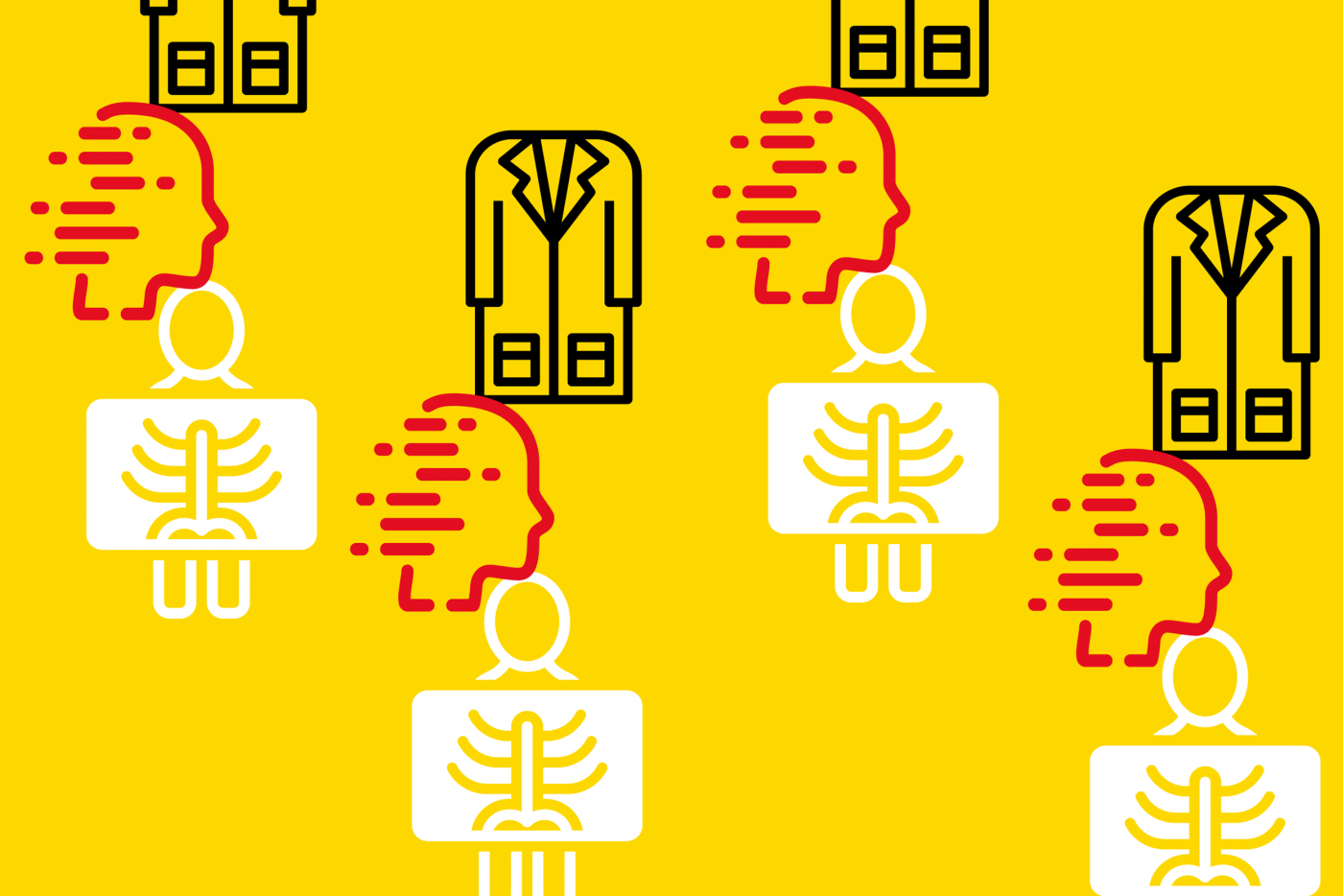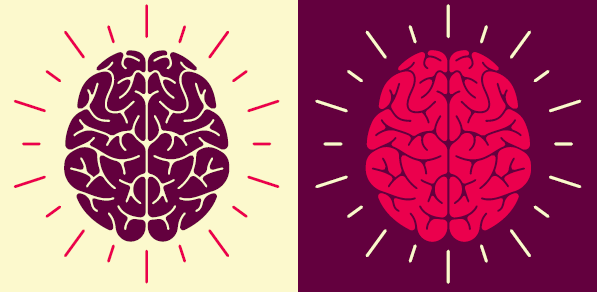L’histoire de la médecine s’écrit bien souvent dans des circonstances particulières. En témoignent les blouses de couleur et la radiographie, des items médicaux nés sur les champs de bataille. Découvrez également le médecin qui a donné son nom à la maladie d’Alzheimer.
Coup de blouses
 Depuis toujours les soignants portent la couleur blanche : blouse, veste, ou drap, elle est un symbole de propreté, d’hygiène et de professionnalisme. C’est d’ailleurs pour cela que les médecins sont parfois surnommés « les blouses blanches ».
Depuis toujours les soignants portent la couleur blanche : blouse, veste, ou drap, elle est un symbole de propreté, d’hygiène et de professionnalisme. C’est d’ailleurs pour cela que les médecins sont parfois surnommés « les blouses blanches ».
Durant la Première Guerre mondiale, avec l’intensification des armes explosives, les médecins étaient réquisitionnés sur le champ de bataille pour prendre en charge les nombreux blessés qui nécessitaient des soins immédiats. Les blessures de guerre étaient sérieuses et les médecins opéraient les patients dans des tentes de fortune avec un équipement rudimentaire. Les petits matins avaient des airs de boucherie comme en témoignaient les blouses blanches maculées de sang. C’est ainsi qu’un chirurgien, au nom oublié, proposa l’utilisation de blouses vertes qui, en raison de la complémentarité du vert avec le rouge, atténuaient l’effet sanguinolent.
Par la suite, un chirurgien du nom d’Harry Sherman recommanda le port de blouses vertes dans le bloc opératoire ; selon lui, cette couleur minimisait la réflexion de la lumière et était moins fatigante pour les yeux. De plus, les taches de sang sur les blouses et draps chirurgicaux se faisaient moins présentes et cela permettait aux chirurgiens de se focaliser sur les nuances rouges du champ opératoire.
Le bleu fit son apparition dans les années 50-60, à l’époque où les opérations commençaient à être filmées, pour la fiction ou à visée éducative. Fut alors invoquée la photogénicité du bleu à l’écran.
Des médecins sont depuis revenus sur ces histoires hautes en couleur, affirmant que la couleur des blouses en elle-même ne changeait pas grand-chose au confort visuel des chirurgiens. En revanche, il semblerait que l’aspect organisationnel ait favorisé l’utilisation de ces différentes couleurs pour différencier la fonction de chaque vêtement : ceux devant être jetés et ceux pouvant être portés dans l’hôpital. Cela permet également d’identifier les soignants, comme en témoignent les séries médicales où les médecins apparaissent en blouse blanche, les chirurgiens en vert ou bleu, les sages-femmes et infirmières en rose, etc.
La maladie d’Alzheimer
Par le Dr Aloïs Alzheimer
Le 3 novembre 1906, le Dr Aloïs Alzheimer rapporte le cas d’une patiente décédée de 50 ans, admise 5 ans auparavant pour paranoïa, troubles progressifs du sommeil et de la mémoire, comportements erratiques et confusion. Il présente alors devant l’assemblée du 37e congrès des psychiatres allemands du Sud-Ouest ses observations, suite à l’examen au microscope du cerveau de sa patiente. En effet, en étudiant les échantillons au microscope, le Dr Alzheimer a remarqué la présence de lésions très particulières (les plaques et les agrégats) qu’il a associée aux troubles non traitables de sa patiente. Quelques années plus tard, le Dr Alzheimer prend en charge un patient aux symptômes semblables à ceux de sa première patiente, et lui diagnostique une maladie d’Alzheimer. D’abord considérée comme une maladie psychiatrique, la maladie est ensuite explorée par les neurologues et classée parmi les démences séniles.
Aloïs Alzheimer, psychiatre allemand, né en 1864, se forma auprès d’Émil Kraepelin, un médecin qui s’intéressait à l’étude du cerveau pour la compréhension des maladies psychiatriques. Sa spécialisation en psychiatrie eut lieu durant ses études de médecine, lorsqu’il fut engagé par une riche famille allemande pour accompagner une jeune fille atteinte d’une maladie mentale, le temps d’un voyage de 5 mois. Aloïs Alzheimer postula à son retour comme assistant à l’hôpital psychiatrique municipal de Francfort-sur-le-Main. Par la suite, aux côtés de Kraepelin, il mena des recherches cliniques approfondies sur le lien entre « l’esprit et la matière ». Mais sa découverte ne suscita que très peu d’intérêt lors du congrès des psychiatres. En effet, Alfred Hoche, le président de session, était un fervent opposant au travail de Kraepelin et balaya la présentation d’Aloïs Alzheimer. Persévérant dans ses recherches, le Dr Alzheimer finit par être reconnu pour son travail et ses observations permirent aux chercheurs du monde entier de continuer à étudier cette maladie après sa mort, en 1915.
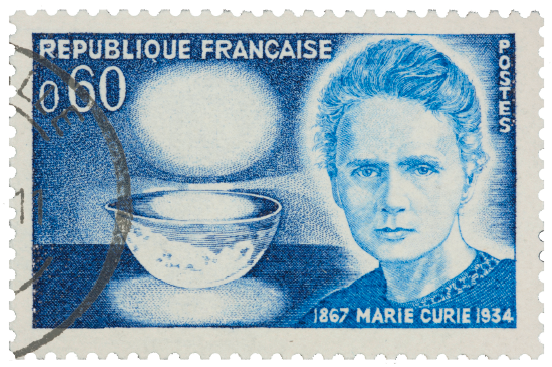 Les rayons X
Les rayons X
Par Marie Sklodowska-Curie
Née en Pologne en 1867, Marie Sklodowska- Curie est une des quatre scientifiques de l’histoire à avoir reçu deux Prix Nobel. Elle fut ainsi récompensée en 1903, avec son mari Pierre Curie et leur collègue Henri Becquerel, pour leurs travaux sur la radioactivité, puis en 1911 pour sa découverte du radium et du polonium. L’ensemble de ses travaux permit de développer la radiographie, technique qui a alors révolutionné la médecine et dont on ne pourrait se passer aujourd’hui. `
Étudiante brillante et passionnée, Marie Sklodowska quitte la Pologne pour la France car dans son pays, à cette époque, les femmes n’ont pas le droit d’accéder à l’enseignement supérieur. Ses études terminées, elle rencontre Pierre Curie, professeur de physique à l’École municipale de physique et de chimie industrielles. C’est alors une relation scientifique, amicale et amoureuse qui se crée entre les deux scientifiques, et celle-ci les entraînera dans de grands travaux de recherche sur la radioactivité. De découverte en découverte, ils gravissent tous deux les échelons et Marie Sklodowska-Curie est nommée, à la mort de son mari en 1906, directrice du laboratoire et chargée de cours à la faculté des Sciences de Paris (devenant ainsi la première femme professeure des universités en France).
 En 1909, l’université de Paris décide de consacrer un laboratoire aux recherches de Marie : l’Institut du radium. Alors que les bâtiments sont presque achevés, la Première Guerre mondiale frappe la France, et Marie concentre toutes ses recherches sur le développement d’appareils à rayons X fixes et mobiles. Accompagnée de sa fille aînée, Irène, elle se rend sur le front avec les « Petites Curies », des voitures radiologiques permettant de faire passer des radiographies aux blessés et de localiser les projectiles reçus. Durant sa mobilisation, Marie Sklodowska-Curie forme de nombreuses manipulatrices et leur enseigne à vitesse grand V les bases élémentaires des mathématiques et de la physique.
En 1909, l’université de Paris décide de consacrer un laboratoire aux recherches de Marie : l’Institut du radium. Alors que les bâtiments sont presque achevés, la Première Guerre mondiale frappe la France, et Marie concentre toutes ses recherches sur le développement d’appareils à rayons X fixes et mobiles. Accompagnée de sa fille aînée, Irène, elle se rend sur le front avec les « Petites Curies », des voitures radiologiques permettant de faire passer des radiographies aux blessés et de localiser les projectiles reçus. Durant sa mobilisation, Marie Sklodowska-Curie forme de nombreuses manipulatrices et leur enseigne à vitesse grand V les bases élémentaires des mathématiques et de la physique.
Toutes ces années passées au contact d’éléments radiographiques auraient causé une anémie aplasique dont elle décède en 1934.
Par Juliette Dunglas
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry