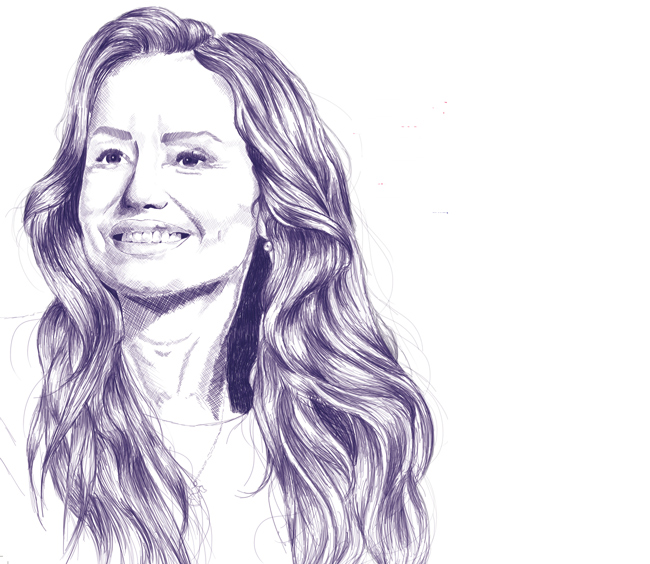Adriana Karembeu, Eva Longoria, Monica Bellucci… Les stars sont souvent mises en avant lorsque leur ventre de quarantenaires s’arrondit. Sont-ce des grossesses comme les autres ? Quels sont les risques pour la mère et pour l’enfant ? On vous dit tout !
Une société qui change, les femmes aussi
Parce que la femme n’a pas voulu d’enfant avant, préférant par exemple mettre la priorité sur sa carrière, parce que le potentiel géniteur a tardé à venir ou encore parce que l’enfant n’arrive pas toujours quand on veut et comme on veut, les grossesses après 40 ans, voire 45, sont de plus en plus fréquentes dans les pays développés. Chaque femme a ses raisons.
D’un point de vue statistique, les chiffres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) le confirment : en 1980, 3 % des nouveau-nés avaient une mère de 40 ans ou plus, alors qu’ils étaient 9 % en 2015. Leur nombre a donc triplé en 35 ans !
Quelle fertilité après 40 ans ?
Les femmes sont fertiles de leur puberté à la ménopause. Si le stock d’ovocytes (on parle de réserve ovarienne) est très important à la naissance, il diminue progressivement dès la puberté et, à partir de 35 ans, rapidement. La quantité et la qualité des ovocytes diminuent également avec le temps, les anomalies chromosomiques sont donc plus nombreuses, responsables notamment de fausses couches ou d’une plus grande fréquence de trisomies. Lorsque la réserve ovarienne est épuisée, c’est la ménopause. Et malheureusement, notre société qui nous fait encore nous sentir jeunes jusqu’à 50 ans (âge moyen de la ménopause en France) ne coïncide pas avec l’âge de nos ovaires…
La procréation médicalement assistée en renfort
S’il est donc possible d’avoir naturellement un enfant après 40 ou 45 ans, des ovocytes pouvant être encore présents dans la réserve, la probabilité d’être enceinte est néanmoins fortement réduite. Le recours à la procréation médicalement assistée (PMA) est courant et remboursé en France par l’Assurance maladie. La fécondation in vitro (FIV) est autorisée jusqu’aux 43 ans de la femme, mais ce n’est pas la seule méthode possible. Selon la cause des difficultés de conception (infertilité féminine, masculine ou mixte), les médecins proposent la solution la plus adaptée (don de gamètes, insémination, etc.).
D’autres pays européens (Belgique, Espagne, Italie) ont des réglementations différentes et certaines femmes n’hésitent pas à s’y rendre pour pouvoir être aidées dans leur projet de grossesse. Certains pays, comme la Belgique, proposent également une gestation pour autrui (GPA) éthique, permettant à des femmes souvent plus âgées, ou ayant subi une ablation de l’utérus, par exemple, d’avoir un enfant.
Et la fertilité des hommes ?
La fertilité des hommes décroît aussi avec l’âge : au-delà de 55 ans, les spermatozoïdes sont moins nombreux, moins mobiles et ont plus de malformations. Cependant, leur nombre reste important, et cela n’est pas forcément comparable avec la réserve ovarienne de la femme. D’un point de vue physique, les pères âgés de 30 ans et ceux de 50 ne sont pas les mêmes, et la fatigue postnatale se ressent !
Indispensable entretien préconceptionnel
Une femme, quel que soit son âge, doit consulter régulièrement un gynécologue ou une sage-femme pour son suivi gynécologique, parler par exemple de sa contraception, ou pour anticiper une grossesse. En effet, lors de cette visite annuelle, c’est l’occasion de faire le point sur ce qu’il est possible d’envisager.
« Je demande toujours à mes patientes : avez-vous un projet de grossesse pour l’année à venir ? Si ce n’est pas le cas, nous parlons contraception… Si c’est le cas, j’explique qu’il est important de préparer une grossesse : elle se déroulera d’autant mieux, explique le Dr Harvey, gynécologue. On y discute des antécédents de la femme, de son poids, de ses vaccins (sont-ils à jour ?), des potentiels risques d’anémie, d’hypertension ou de thyroïde… C’est aussi l’occasion de proposer une prescription d’acide folique et de faire des rappels de prévention (pas d’alcool…). »
- L’acide folique se présente sous forme d’un petit comprimé à prendre quotidiennement 2 mois avant la conception et pendant les 2 premiers mois de la grossesse. Il permet de réduire considérablement le risque de spina bifida, une malformation du tube neural qui peut entraîner un mauvais développement de la colonne vertébrale. Le gynécologue peut vous prescrire l’ordonnance d’acide folique, que vous prendrez lorsque votre projet de grossesse verra le jour.
L’association Maia
L’association a été créée en 2001 par Laure Camborieux. Couples, personnes seules, en parcours de FIV classique, de don de gamètes, double don, don d’embryon, d’adoption, ou de GPA, Maia est une association unique et chaleureuse, et pas seulement virtuelle pour l’infertilité. Parmi ses missions : éclairer les pouvoirs publics, informer et soutenir les personnes et couples infertiles dans leur désir d’être parents, faire entendre leur voix, répercuter des retours quant aux pratiques sur le terrain, aider les personnes et couples infertiles à obtenir un traitement sûr et de qualité ainsi qu’un accès équitable aux traitements d’infertilité disponibles dans le respect des règles éthiques et, enfin, poser les questions de la parentalité et de la filiation.
- La prochaine semaine de l’infertilité aura lieu du 4 au 10 novembre 2019.
- Pour plus d’informations : https://maia-asso.org
Le point de vue de l’expert – Le Dr Thierry Harvey
Chef du service de la maternité de l’hôpital des Diaconesses, Paris
Quand parle-t-on de grossesse tardive ?
Au-delà de 40 ans. Les grossesses dites plus à risque sont celles au-delà de 44 ans (à la conception, donc 45 ans à l’accouchement). Mais, dans les faits, une première grossesse à 42 ans est plus « à risque » qu’une troisième à 44 ans, par exemple !
Sont-elles de plus en plus nombreuses ?
Elles sont plus nombreuses, mais finalement elles suivent l’âge de la maternité en général qui recule également depuis des années. Les moyens de concevoir « mis à disposition » sont aussi plus nombreux qu’il y a 20 ou 30 ans.
Quelles différences dans le suivi de ces femmes ?
Étant donné leur âge, ces femmes sont plus suivies, car les risques sont plus nombreux. Elles ont plus de risques de faire une fausse couche, d’avoir un bébé prématuré, une grossesse extra-utérine, un placenta prævia, une césarienne, d’être atteintes de diabète gestationnel ou d’hypertension… Les tests de dépistage sont donc plus nombreux au début de la grossesse.
Conception naturelle ou par PMA, ça change quoi ?
C’est important de le savoir d’un point de vue médical : on sait que la procréation médicalement assistée augmente les risques pour la mère et l’enfant. Il est très important que les femmes disent aux médecins qu’elles consultent si elles ont eu recours ou non à la PMA pour améliorer le suivi. Nous sommes soumis au secret médical, donc cela ne s’ébruitera pas à la belle-mère ou autre… Par exemple, très concrètement, lorsqu’il y a eu un don d’ovocyte à l’origine de la grossesse, on sait qu’il y a une augmentation du risque de pré-éclampsie (hypertension), on anticipera donc sur le terme de la grossesse, faisant diminuer les risques pour la femme, mais aussi pour l’enfant à naître. C’est souvent le dernier trimestre de ces grossesses qui est le plus contrôlé, pour devancer tout problème potentiel à la naissance.
Quels sont les risques pour l’enfant à naître ?
Les risques pour le bébé sont aussi plus nombreux que lorsque la mère est plus jeune : décès in utero, anomalies chromosomiques (trisomies 13, 18, 21), faible poids à la naissance, prématurité, etc. Les techniques ont beaucoup évolué et alors qu’avant on proposait une amniocentèse pour dépister les trisomies, désormais on a accès à des tests non invasifs (nécessitant une prise de sang et l’aide d’échographie) pour effectuer un diagnostic sûr et moins à risque de fausse couche.
Quelques chiffres
- 44 ans est l’âge à partir duquel on parle de grossesse tardive (source : Agence de la biomédecine)
- La PMA augmente les risques pour la mère et pour l’enfant
Par Gaëlle Monfort
 Heart
Heart Sad
Sad Angry
Angry Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay