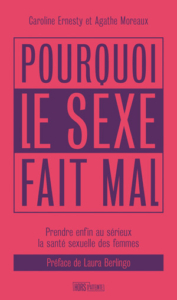Certains rapports sexuels peuvent être douloureux. Cette souffrance physique engendre parfois chez les femmes une forte culpabilité, alors que de réelles causes l’expliquent. Décryptage autour de la santé sexuelle.
C’est normal d’avoir mal », « il faut vivre avec », « c’est dans votre tête », etc. Ces petites phrases couramment prononcées font écho à de nombreuses femmes. Qu’elles les entendent chez le médecin ou au cours de leur vie sexuelle, ces formules ont un effet commun : instaurer une banalisation de la douleur.
Les femmes sont entre 8 et 22 % à souffrir avant, pendant ou après avoir fait l’amour, le plus souvent avec pénétration, selon une étude de la Dr Clarence de Belilovsky. « Il peut y avoir deux grands types de douleurs lors de rapports sexuels, explique la docteure Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les douleurs concernant la vulve — les vulvodynies — et celles se rapportant au vagin, liées à la pénétration — les dyspareunies. Il y a des femmes qui connaissent les deux. »
Dans la pratique, les causes à l’origine de ces douleurs sexuelles sont nombreuses. Pathologies neuromusculaires, maladies chroniques, infections : trop longtemps restées silencieuses, ces souffrances liées au sexe retirent désormais leurs bâillons. Partant des milieux militants féministes, leur prise en compte se répand de plus en plus dans les sphères publiques et médiatiques pour remonter vers les institutions.
L’une des causes : les infections
Un des maux les plus répandus : la cystite. Cette inflammation de la vessie est généralement due à une infection urinaire bactérienne. Considérée comme bénigne, elle entraîne néanmoins des gênes non négligeables : sensations de brûlure, envies fréquentes d’aller aux toilettes et douleurs en urinant.
« Anatomiquement, les orifices urinaire, vaginal et anal sont proches, précise Laura Berlingo. Des bactéries [non présentes à l’origine, contrairement à celles de la “flore”, NDLR] peuvent se retrouver dans l’anus puis dans le vagin, remonter plus facilement au niveau de l’urètre et donc, aller coloniser la vessie. On recommande d’aller uriner après un rapport sexuel, pour nettoyer un peu. » Mais ce n’est pas tout. La responsabilité des partenaires doit aussi être pointée. Comme le fait de passer ses doigts de l’anus au vagin, proche de l’urètre, sans mesure d’hygiène par exemple.
Quand le sexe gratte, pique, brûle à répétition et que les rendez-vous entre cabinet médical et pharmacie s’enchaînent, la libido en prend un coup. Outre les infections récurrentes, dont font aussi parties mycoses et vaginoses — des déséquilibres du microbiote vaginal, souvent dû à la propagation de la bactérie Gardnerella vaginalis —, d’autres pathologies moins connues génèrent aussi des douleurs.
Des contractions
Parmi elles, le vaginisme : « une contraction réflexe au moment de la pénétration pouvant être primaire ou secondaire, éclaircit Laura Berlingo. Primaire quand elle a toujours été là, secondaire lorsqu’elle survient après un évènement : infection très gênante pendant longtemps, violences sexuelles… Même si parfois, il n’y a pas d’identification précise. »
Ce resserrement involontaire des muscles pelviens rend la pénétration douloureuse, voire impossible. Loin d’être « dans la tête », la souffrance réelle peut alors entretenir un cercle vicieux : l’appréhension de la douleur déclenche la contracture, ce qui provoque de la douleur, et ne fait qu’augmenter la crainte d’une tentative de pénétration. Mais il existe des solutions !
Premièrement, la pénétration n’est pas le Graal de la sexualité. La stimulation du clitoris n’est souvent pas empêchée — sauf en cas de clitoridynie, une douleur au niveau du clitoris. Or, dans le cadre hétérosexuel, la sacro-sainte pénétration vaginale fait encore loi. Le plus important est de communiquer avec son ou sa partenaire. Car si cette pratique est toutefois désirée par les deux amants, « le lubrifiant est important et permet de réduire les douleurs », rappelle la gynécologue.
« La prise en charge est multifactorielle »
Deuxièmement, une prise en charge médicale est tout à fait possible. Avant de poser un diagnostic de vaginisme, le médecin éliminera d’autres causes par un examen gynécologique, comme la vestibulodynie par exemple, une vulvodynie localisée à l’entrée du vagin dont 7 % des femmes sont atteintes.
Ensuite « la prise en charge est multifactorielle, complète la Dr Berlingo. Des thérapies physiques — kinésithérapie, avec assouplissement, travail autour du périnée et sa relaxation… — jusqu’aux pratiques complémentaires de sophrologie, yoga, méditation, MBSR (réduction du stress basée sur la pleine conscience) ». Et sans oublier la prise en charge psychologique. « D’abord, car la douleur chronique a des répercussions sociales et psychologiques importantes. Ensuite, car cela fait parfois remonter des antécédents de violences, de violences sexuelles », ajoute-t-elle.
Comme la douleur est banalisée, beaucoup de femmes se disent que « ça va passer ». Elles ne consultent pas, ou alors tardivement. « La société change, de la même façon que la médecine, en s’inscrivant dans une histoire, conclut la gynécologue. La génération de jeunes médecins prend davantage en compte les douleurs, la parole des patientes, le consentement, tout ce qui a été rapporté par les mouvements dénonçant les violences gynécologiques et obstétricales », ayant fait suite au mouvement #MeToo. Depuis la médiatisation de ces violences, un diplôme universitaire « Santé sexuelle pour tous·tes » a été créé à la Sorbonne, visant à mieux former les professionnels du soin à ces enjeux.
Afin d’améliorer la prise en charge de la douleur sexuelle, mieux vaut s’adresser à un médecin spécialiste (dermatologue vulvaire ou gynécologue spécialisé) travaillant en lien avec des kinésithérapeutes et des psychosexologues. À ce titre, l’association Les Clés de Vénus propose un accompagnement et un annuaire de professionnels formés à ces questions partout en France.
« La génération de jeunes médecins prend davantage en compte les douleurs, la parole des patientes, le consentement »
– Dr Laura Berlingo, gynécologue obstétricienne
À LIRE
Cette question peut paraître contre-intuitive de prime abord. Et pourtant, force est de constater que les rapports sexuels ne sont pas systématiquement synonymes de parties de plaisir. Dans leur livre-enquête, Pourquoi le sexe fait mal (Éditions Hors d’Atteinte, 2025), les deux journalistes Caroline Ernesty et Agathe Moreaux retracent, à travers une dizaine de témoignages de femmes et des entretiens avec des chercheurs et chercheuses, les raisons d’une santé sexuelle féminine délaissée.
Instrumentalisation du corps voué à l’unique reproduction, biais de genre dans les études scientifiques, charge sexuelle s’additionnant à la charge mentale et nombreux scandales sanitaires : les femmes n’ont décidément pas les mêmes avantages que les hommes en termes de santé sexuelle. En plus du reste. Ce livre permet de comprendre pourquoi ce sont les mâles qui façonnent la sexualité. Et d’explorer les pistes d’une révolution sexuelle féministe !
Par Sacha Citerne
 Heart
Heart Yay
Yay Haha
Haha Wow
Wow Sad
Sad Angry
Angry