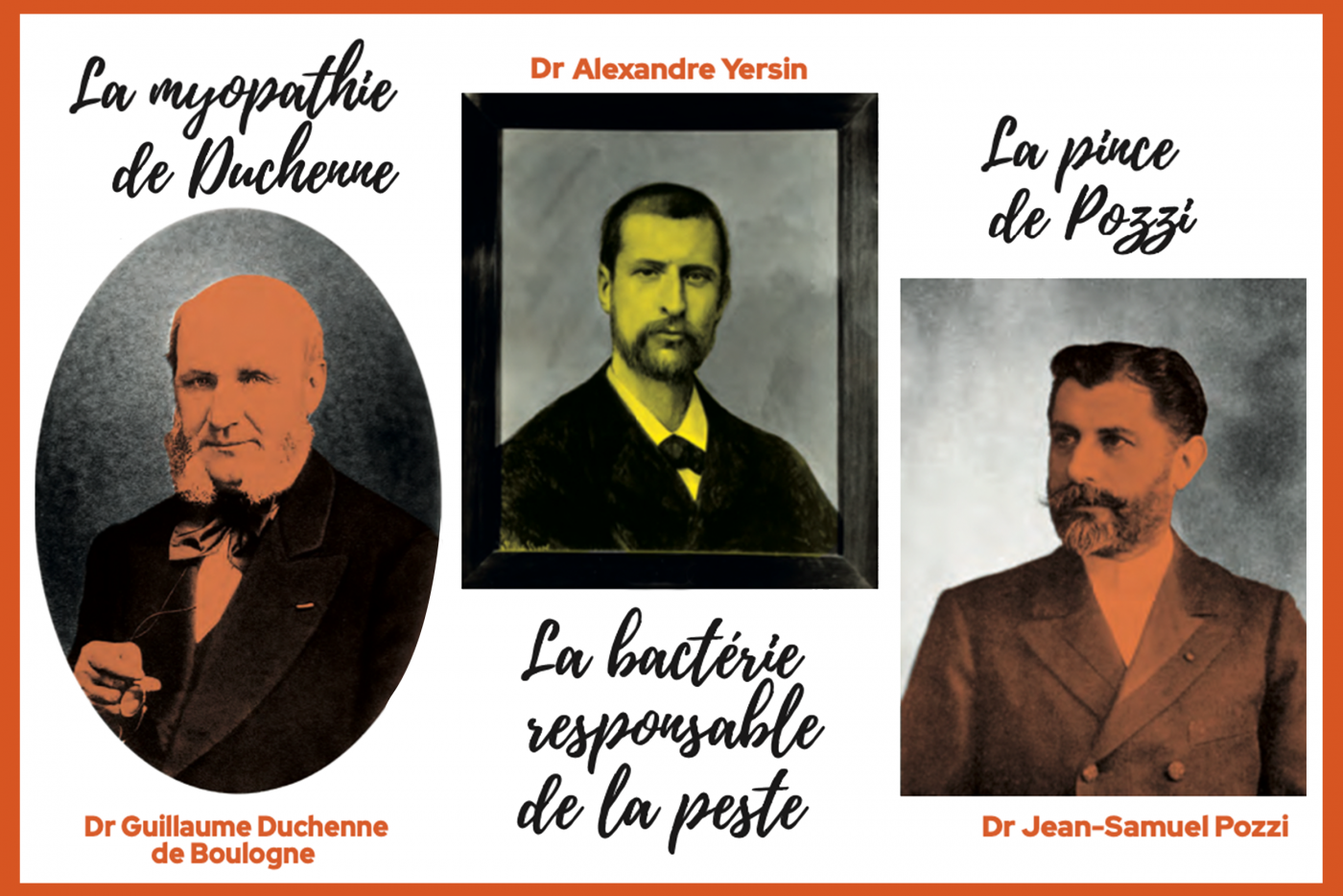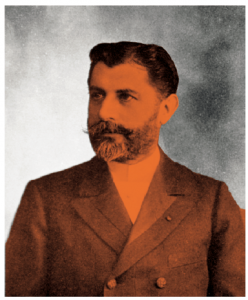Nous connaissons les médecins comme des personnes qui nous soignent. Mais ce sont aussi parfois des inventeurs, des découvreurs et même des chercheurs de talent ! Voici l’histoire de trois d’entre eux.
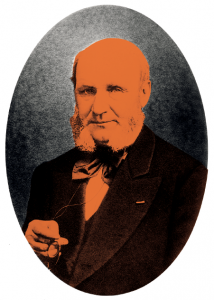 La myopathie de Duchenne
La myopathie de Duchenne
par le Dr Guillaume Duchenne de Boulogne
Tous les Français ou presque ont déjà entendu parler de la myopathie de Duchenne par le biais du Téléthon*, événement organisé chaque année par l’association AFM-Téléthon dans toute la France. AFM signifie Association française contre les myopathies. Pourtant, le saviez-vous, la maladie pour laquelle a été créé le Téléthon (qui rassemble désormais toutes les familles luttant contre les maladies génétiques rares), la myopathie de Duchenne, porte le nom d’un neurologue : le Dr Guillaume Duchenne ?
Il est né en 1806 à Boulogne-sur-Mer et décédé en 1975 à Paris. Après des études de médecine à Paris, Guillaume Duchenne choisit d’y exercer à partir de 1842 et d’étudier l’effet thérapeutique de l’électricité, tout en revendiquant une liberté dénuée d’ambition académique. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des fondateurs de la neurologie moderne avec son traité « De l’électrisation localisée » (1855) où il a décrit une anatomie précise, et notamment des paralysies grâce à des expériences où l’électricité sert à faire réagir les nerfs des patients. Il expérimente l’électricité comme moyen à la fois curatif et d’exploration de l’anatomie. Ses recherches se sont particulièrement intéressées aux muscles et c’est alors qu’il a fait la première description de la paralysie atrophique graisseuse de l’enfance, rebaptisée plus tard myopathie de Duchenne, ainsi que de la maladie de Duchenne de Boulogne.
Photographe, il immortalise ses découvertes par des clichés désormais cultes. Pour Duchenne, chaque muscle du visage exprime une émotion. La différence entre l’authentique sourire (nommé aussi sourire de Duchenne) qui implique les muscles autour de la bouche et aussi des yeux, contrairement au « faux » sourire dit de politesse qui n’implique pas les yeux. Les différentes émotions seront ainsi détaillées, muscle par muscle, par Duchenne et serviront à de nombreux neurologues dans le monde entier. Dans l’univers médical, il reste ainsi une référence pour ses expériences liées à l’électricité et l’expression des émotions chez les Hommes comme chez les animaux.
*Le Téléthon a lieu chaque premier week-end du mois de décembre et toute l’année sur afm-telethon.fr
La bactérie responsable de la peste
par le Dr Alexandre Yersin
« Il les connaît, Yersin, les deux langues et les deux cultures, l’allemande et la française, et leurs vieilles querelles. Il la connaît aussi, la peste. Elle porte son nom. Depuis quarante-six ans déjà, en ce dernier jour de mai 1940 où pour la dernière fois il survole la France dans son ciel orageux. » Extrait de Peste et choléra, Patrick Deville par le Dr Alexandre Yersin
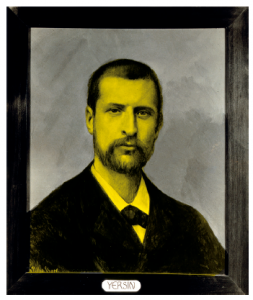 Médecin et bactériologiste francosuisse, le Dr Alexandre Yersin fut le découvreur du bacille de la peste, nommé aujourd’hui Yersinia pestis. Il fit ses armes au côté d’un certain Louis Pasteur.
Médecin et bactériologiste francosuisse, le Dr Alexandre Yersin fut le découvreur du bacille de la peste, nommé aujourd’hui Yersinia pestis. Il fit ses armes au côté d’un certain Louis Pasteur.
La peste existait bien avant l’identification du bacille par le Dr Yersin. Cette maladie est à l’origine de trois pandémies jusqu’à maintenant.
La première pandémie de peste de l’histoire s’étend de 541 à 767 dans le bassin méditerranéen. Sa longue période s’explique par la succession de vagues de contamination qui ont duré chacune une dizaine d’années, gagnant chaque fois de nouveaux foyers épidémiques.
La seconde pandémie de peste, plus connue sous le nom de peste noire, a débarqué en Europe par bateau en 1347 et l’a quittée en 1352 après avoir décimé près de la moitié de la population européenne !
La troisième et dernière pandémie, à ce jour, est celle qui a été propice à l’identification du bacille par Yersin. En juin 1894, l’Institut Pasteur demande au Dr Yersin d’étudier les origines de cette nouvelle épidémie de peste qui fait rage en Chine. Installé dans une paillote lui servant de laboratoire, Yersin se sert des dépouilles de pestiférés…
« Le bubon est bien net. Je l’enlève en moins d’une minute et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une préparation et la mets sous le microscope. Au premier coup d’oeil, je reconnais une véritable purée de microbes, tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémités arrondies. […] Yersin est le premier homme à observer le bacille de la peste […]. En une semaine, Yersin rédige un article qui paraîtra dès septembre dans les Annales de l’Institut Pasteur ». Extrait de Peste et choléra, Patrick Deville.
Après des années en France, il partit définitivement pour l’Indochine française où il continua d’autres recherches et fonda l’École de médecine de Hanoï (Vietnam). Son décès à 79 ans suscita une vive émotion dans ce pays où il était très apprécié. Timbre, bourse d’études, musée, nom de rue… il fut finalement nommé citoyen d’honneur du Vietnam.
La pince de Pozzi
Le Dr Jean-Samuel Pozzi était un médecin-chirurgien français du XIXe siècle. Membre de l’Académie de médecine, professeur à la Faculté de médecine de Paris, il fut un pionnier de la chirurgie moderne, mais également de la gynécologie. Une pince et un muscle portent d’ailleurs son nom, ainsi qu’une maladie renommée depuis, selon le Dr Paget.
Ce sont les femmes qui généralement ont déjà entendu ce nom, car la pince de Pozzi ou tenaculum est utilisée par les gynécologues pour accéder facilement et de façon sûre à la cavité utérine. Elle permet en fait de bloquer le col de l’utérus lors des examens pour effectuer des vérifications de routine ou poser un dispositif intra-utérin.
Le muscle de Pozzi, quant à lui, est un muscle qui permet d’étendre les doigts et dont la présence est variable selon les personnes.
Très intégré dans la vie mondaine parisienne et gynécologue de ces dames, on lui prête de nombreuses aventures dont la célèbre actrice Sarah Bernhardt. Il soigna les familles Proust, Rothschild ou encore de Polignac qu’il connaissait très bien.
Ce n’est pas pour autant qu’il oublia ses terres d’origine puisque le Dr Pozzi fut conseiller général puis sénateur de la Dordogne où l’hôpital de Bergerac porte aujourd’hui son nom.
À la fin de sa vie, alors que la Première Guerre mondiale était déclarée, il dirigea plusieurs centres de blessés et fit avancer les procédés de désinfection et de traitement des plaies. Sa mort fut pour le moins tragique, car il fut assassiné par un patient devenu fou, l’accusant d’avoir raté son opération.
Par Juliette Dunglas et Gaëlle Monfort
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry