Description
La maladie de Lyme (ou borréliose), une maladie rare ? Avec plus de 300 000 nouveaux cas recensés par an aux États-Unis, il semblerait que non. « En France, il est difficile de se faire une idée précise de la fréquence de la maladie, certainement largement sous-estimée », précise le Pr Christian Perronne, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches et vice-président de la Fédération française des maladies vectorielles à tiques. Avec des cas retrouvés un peu partout dans le monde (en Russie, au Japon, au Canada, en Hollande, en Afrique du Nord…), il s’agirait même pour certains spécialistes de l’épidémie mondiale la plus importante transmise par un vecteur, en l’occurrence la tique.
Les oiseaux, rongeurs et animaux domestiques, comme les chiens et les chats, peuvent être porteurs de la bactérie Borrelia burgdorferi responsable de la maladie de Lyme. Mais celle-ci est essentiellement transmise à l’homme par l’intermédiaire des tiques infectées. Majoritairement présentes en forêt, les tiques s’accrochent sur la peau et y font pénétrer leur harpon, afin de se nourrir du sang de leur victime. Les jeunes tiques, ou nymphes, sont très nombreuses et à peine plus grosses qu’une tête d’épingle. Les adultes peuvent atteindre la taille d’une cacahouète une fois gorgées de sang. « Malheureusement, les piqûres de tiques passent souvent inaperçues, dans des zones comme le cuir chevelu ou la raie des fesses, et beaucoup de patients atteints de la maladie de Lyme n’ont pas le souvenir d’avoir été piqués par une tique », rappelle le Pr Christian Perronne.
Les symptômes
Le premier signe témoignant d’une infection est l’apparition d’une lésion cutanée, nommée érythème migrant, à l’endroit de la piqûre. Il s’agit d’une petite rougeur, de taille variable, généralement peu prise au sérieux, car confondue avec de l’eczéma. « L’apparition d’une tache rouge après un retour de forêt, ce n’est pas une plaque d’eczéma, ce n’est pas une piqûre d’araignée, c’est très certainement une maladie de Lyme », souligne le Pr Christian Perronne. Cependant, une fois sur quatre environ, il n’y a pas de lésion cutanée, rendant le diagnostic encore plus difficile.
La maladie de Lyme évolue en plusieurs phases. Traitée précocement au stade d’érythème migrant, la maladie est généralement de bon pronostic. En revanche, en l’absence de traitement, elle peut évoluer silencieusement vers une forme chronique. La bactérie peut ainsi sommeiller pendant des mois ou des années dans l’organisme, se réveiller de temps en temps, jusqu’à atteindre un stade où les symptômes ne peuvent plus être ignorés par la personne atteinte. « Le fond commun, c’est une grande fatigue et des douleurs généralisées », décrit Christian Perronne. Mais les symptômes peuvent également être d’ordre neurocognitif avec des troubles de la mémoire, de la concentration, de l’humeur, du sommeil, ou neurologiques, avec des paralysies faciales, des sciatiques, des méningites… Par ailleurs, des atteintes cutanées et des douleurs articulaires sont souvent retrouvées.
« Les symptômes ne sont pas forcément permanents, explique le Pr Christian Perronne, ce qui n’est pas toujours évident à comprendre pour l’entourage. Les patients peuvent courir quelques km un jour et être incapables de se lever la semaine d’après ».
La maladie de Lyme peut donc être un véritable calvaire pour les patients, avec des symptômes souvent « subjectifs » et « invisibles » pour les personnes qui les entourent.
Diagnostic et traitements
Le diagnostic sérologique de la maladie de Lyme consiste à rechercher dans le sang les anticorps produits par l’organisme en réaction à l’intrusion de la bactérie. « Actuellement, les tests utilisés manquent de sensibilité et il est fréquent de passer à côté d’une maladie de Lyme », témoigne le Pr Christian Perronne. La recommandation est donc de traiter immédiatement tout érythème migrant par antibiotiques, sans attendre la sérologie.
Les maladies de Lyme chroniques peuvent être traitées par des cures d’antibiotiques prolongées, en alternant les antibiotiques ou en les associant. « On ne donne pas nécessairement des antibiotiques en continu, explique le professeur. Du fait de l’infection simultanée par d’autres bactéries ou des parasites, on peut également prescrire des antiparasitaires ou des antifongiques. Les patients ne réagissent pas de la même manière aux traitements, et c’est par tâtonnements que l’on parvient à trouver la bonne combinaison », ajoute-t-il. La plupart des cures durent 3 à 6 mois, remplacées ensuite par des traitements alternés ou séquentiels. Les traitements alternatifs comme la phytothérapie trouvent également leur place.
La bactérie présente cependant une capacité exceptionnelle à persister dans le corps, même après traitement. « On assiste parfois à une réapparition des symptômes chez des patients qui n’en présentaient plus depuis des années, témoigne le professeur, souvent à l’occasion d’un stress ou d’une baisse des défenses immunitaires. Au fil du temps, les patients peuvent aussi apprendre à anticiper les crises et à gérer leur maladie ».
Le combat contre la maladie de Lyme ne fait que commencer. Le Canada a passé une loi reconnaissant la forme chronique de la maladie. Aux États-Unis, les recommandations évoluent et des recherches sont menées pour mettre au point de nouveaux tests, plus fiables. Mais avant tout, il faut penser prévention (voir encadré) et prendre conscience de la dangerosité des tiques qui, loin d’être anodines, sont vectrices de maladies.
Clémentine Vignon
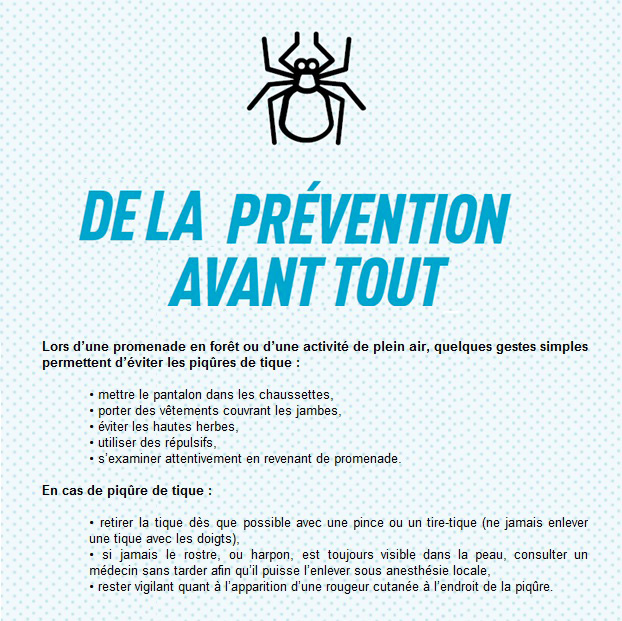
 Angry
Angry Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad


