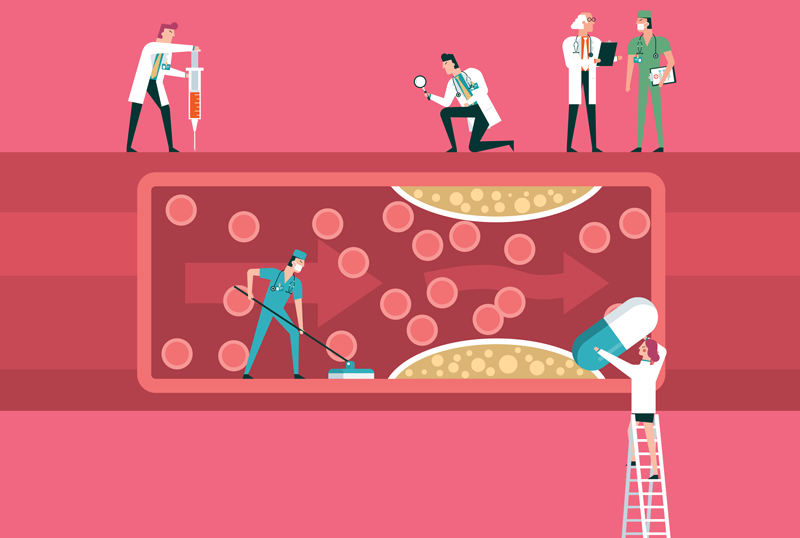Vocation Santé est allé à la rencontre des scientifiques de l’ombre. Dissimulés dans les laboratoires d’analyses, les biologistes médicaux font partie intégrante de nos parcours de soin, sans être forcément connus et reconnus.
Il est 6 h, le réveil sonne. Au saut du lit j’enfile rapidement un pantalon et un pull, et me traîne à la salle de bain pour me passer de l’eau sur le visage. Encore embuée de ma nuit, je pense tout de suite à prendre un café pour me réveiller, et me rappelle vite la consigne « être à jeun depuis 12 heures ». Tête dans le guidon, ordonnance et carte vitale en main, je me rends au laboratoire d’analyses au coin de ma rue où m’attend déjà une file d’exceptionnels lève-tôt qui finissent leur nuit, ticket en main. Un passage par l’accueil suivi d’un moment dans la salle d’attente, et j’entends finalement mon nom. J’atterris alors dans une petite salle où l’on me fait asseoir pendant que des mains s’affairent à coller des étiquettes sur des tubes, me demandant prénom, nom et date de naissance. Après quelques secondes plus ou moins agréables, je sors avec un pansement dans le creux du coude pendant que des tubes remplis de mon sang s’éloignent sur un porte-éprouvettes, franchissant les portes d’une pièce inconnue.
Quelques heures, quelques jours plus tard, je recevrai « dès 17 h » une notification m’indiquant que mes résultats sont disponibles en ligne et qu’ils ont été transmis à mon médecin. Simple et rapide, presque aussi facile que d’aller poster une lettre. Pourtant, se cachent derrière les portes de cette pièce inconnue de « petites mains » et un véritable déploiement de compétences et de connaissances.
« Tout le monde connaît les laboratoires de biologie médicale, mais peu connaissent les biologistes qui y travaillent. Or ce sont eux qui font fonctionner le laboratoire ! »
Qu’est-ce que la biologie médicale ?
Pour découvrir le métier de biologiste médical, je suis allée à la rencontre des Drs Philippe Chatron et Bernard Massoubre, officiant tous deux dans des laboratoires de biologie médicale de ville.
La biologie médicale est un outil utilisé par les médecins pour prévenir, diagnostiquer et pronostiquer des maladies. Elle permet également de suivre l’efficacité et la toxicité de traitements mis en place. Communément décrite comme « l’étude des liquides biologiques », elle cache derrière cette appellation de nombreuses spécialités : l’étude des éléments figurés du sang et de la moelle osseuse, de la coagulation et de la composition chimique du sang, l’analyse bactériologique, virologique, parasitologique et mycologique, l’étude du génome humain et de ses maladies, l’aide médicale à la procréation, la mise en évidence d’une probable allergie, l’étude des groupes sanguins… Les examens de biologie médicale sont une aide au diagnostic dans 70 % des cas et font partie des examens paracliniques (comme la radiologie), ils ont donc une visée médicale humaine.
Le métier
C’est un métier qui demande, à la manière d’un chef d’entreprise, de connaître et maîtriser les nombreux champs de compétences des différents professionnels qui travaillent dans les laboratoires. Les biologistes médicaux sont des médecins ou pharmaciens spécialistes qui encadrent des ingénieurs, des techniciens, des secrétaires et des infirmiers. Ils sont surtout garants de la qualité des résultats produits, et ont une véritable responsabilité médicale.
Les études
On accède au métier de biologiste médical par des études de médecine ou de pharmacie durant lesquelles, après le concours de l’internat, la spécialisation de biologie médicale sera choisie. Cela représente environ 10 ans d’études, sauf si l’on souhaite se spécialiser encore en obtenant un autre diplôme universitaire par exemple.
Plusieurs lieux permettent d’exercer par la suite, soit en activité libérale, dans un laboratoire de biologie de ville (70 % des biologistes), soit comme hospitalier, généralement dans un service spécialisé (procréation médicale assistée par exemple). D’autres se dirigent vers des carrières dites hospitalo-universitaires, après avoir passé une thèse de sciences, où ils partagent leur temps entre l’enseignement et la recherche appliquée en biologie médicale.
Le chemin d’un prélèvement
Le prélèvement, réalisé en établissement de soins, au laboratoire, par les équipes du laboratoire ou à domicile (par un infirmier libéral), est acheminé sur le plateau technique où il va être analysé. Il est ensuite enregistré par le secrétariat et est envoyé dans le circuit d’analyses selon les prescriptions faites par le médecin.
Ce sont ensuite les techniciens de laboratoire qui prennent en charge le prélèvement pour la phase préanalytique qui consiste à préparer les échantillons pour l’analyse en fonction des caractéristiques particulières du liquide biologique. Un tube de sang ne se met pas simplement dans une machine produisant automatiquement les résultats !
Enfin, les prélèvements sont éliminés par une filière particulière de déchets biologiques.
Bien que tous ces processus suivent aujourd’hui des procédures rapides, maîtrisées et fiables, il est nécessaire de les mettre à jour systématiquement pour prendre en compte l’actualité scientifique et les situations exceptionnelles, telle la pandémie de Covid-19. Cette dernière a en effet poussé les laboratoires d’analyses à atteindre des capacités de traitement assez extraordinaires en très peu de temps, tout en composant avec les contraintes inhérentes à la situation et en assurant leurs tâches quotidiennes.
Une journée dans la peau du biologiste médical
Sur chaque plateau technique, plusieurs biologistes médicaux prennent chacun la responsabilité d’un secteur pour toute la durée du cycle d’analyses. La journée commence à l’accueil du laboratoire par la réalisation des prélèvements, un moment d’échanges privilégié avec les patients. Le biologiste disparaît ensuite aux yeux du patient et passe du côté technique de son laboratoire, sur le plateau technique. Là, il supervise l’arrivée des prélèvements au cours de la journée, fait le point avec les techniciens sur les tâches du jour, valide les résultats des échantillons de contrôle avant de faire partir le prélèvement dans le cycle d’analyses. Ce dernier comportera un ou plusieurs tests réalisés de manière manuelle, semi-automatique ou automatique (à l’aide de machines). Il valide tous les résultats des examens émis sur son plateau et dont il est responsable, ainsi que le dossier du patient après que tous les résultats auront été rassemblés et rendus. Parfois cela peut prendre du temps car certains tests auront été faits sur un plateau technique situé dans un autre site.
Le biologiste passe alors à un travail de synthèse des résultats obtenus. Il va ensuite établir un dialogue avec le prescripteur de l’ordonnance (médecin généraliste, endocrinologue, urologue, cardiologue, gynécologue…) si les résultats relèvent d’une certaine gravité, d’une urgence médicale, ou si les résultats sont incohérents ou incomplets.
Il sera enfin disponible pour les médecins prescripteurs, mais également pour les patients, même si l’informatisation permet désormais aux médecins d’obtenir très rapidement les résultats de leurs patients, sans avoir forcément à passer par le biologiste médical.
En parallèle, le biologiste médical gérera, au fil de l’eau, les éventuels problèmes techniques ou organisationnels se présentant dans la journée. Il veillera au bon déroulement du flux de prélèvements et d’analyses dans son laboratoire.
Il lui faudra également trouver du temps scientifique et médical pour se tenir au courant des dernières avancées dans son domaine, lire des articles, se mettre à jour sur les recommandations et les bonnes pratiques, ou encore se rendre en congrès pour participer à des travaux.
Enfin, en tant que responsable, il se chargera de la qualité des procédures de son laboratoire, de la logistique, de la formation des professionnels qu’il encadre, etc.
Conclusion
Il est parfois tentant de penser que les métiers de la biologie médicale se résument à de la haute technologie faisant automatiquement les manipulations et l’analyse. Pourtant ces professionnels de santé sont les experts d’une biologie médicale de plus en plus scientifique et complexe et participent activement à la prise en charge de leurs patients au sein d’une équipe médicale multidisciplinaire. Les biologistes médicaux hospitalo-universitaires sont également indispensables à la recherche fondamentale et appliquée pour la mise en œuvre de procédés techniques innovants, associés, dans le futur, aux moyens de l’intelligence artificielle.
70 % des biologistes exercent en activité libérale.
Par Juliette Dunglas, en collaboration avec les Drs Philippe Chatron (Académie nationale de pharmacie, Société française de biologie clinique) et Bernard Massoubre (Académie nationale de pharmacie)
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry