Douleurs, diarrhées, fatigue… Si la maladie de Crohn altère la qualité de vie, les traitements disponibles aujourd’hui peuvent aider à améliorer le quotidien des patients.
En 2008, Tiphany Dalli-Verrecchia a été diagnostiquée atteinte de la maladie de Crohn. Elle avait 20 ans et souffrait de maux de ventre très importants associés à de la fièvre. Contrairement à de nombreux patients, qui attendent parfois un an pour obtenir un diagnostic, elle a été prise en charge très rapidement par son médecin traitant. En quelques mois, le résultat est tombé : ses symptômes étaient la conséquence d’une forme sévère de la maladie de Crohn.
« La période propice au déclenchement de la maladie intervient généralement entre 16 et 25 ans, même si on constate depuis quelques années une augmentation des cas pédiatriques. Le diagnostic est parfois difficile à poser, d’autant que les symptômes peuvent être vagues. Beaucoup de médecins pensent qu’il s’agit d’une crise de stress ou d’une gastro-entérite et ne renvoient pas vers les spécialistes », explique Tiphany Dalli- Verrecchia, aujourd’hui déléguée de l’AFA-Crohn- RCH (association de soutien aux patients atteints de la maladie de Crohn et de rectocolites hémorragiques) en région PACA.
« La période propice au déclenchement de la maladie intervient généralement entre 16 et 25 ans. »
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire — de cause inconnue — qui peut atteindre tous les segments du tube digestif, de la bouche à l’anus. Elle touche autour de 150 000 personnes en France. Elle altère beaucoup la qualité de vie par ses symptômes chroniques (diarrhées, douleurs, perte de poids, fatigue), par sa localisation anale très invalidante présente dans la moitié des cas et par ses complications (occlusions, abcès, fistules, anémie).
Contrôler la maladie
Si à l’heure actuelle aucune guérison n’est possible, les traitements disponibles permettent d’obtenir un contrôle durable de la maladie et une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, de nombreuses pistes de recherche se dessinent depuis plusieurs années, avec l’objectif d’améliorer encore la prise en charge.
« Le traitement contre la maladie de Crohn a pour but de permettre une cicatrisation de l’intestin en contrôlant l’inflammation. Ainsi, il permet la cicatrisation mais ne guérit pas de cette maladie, ce qui rend indispensable un traitement d’entretien pendant des années pour éviter les rechutes. Néanmoins, une faible proportion de patients reste stable sans traitement. Pour les autres, l’arsenal thérapeutique repose principalement sur trois classes de traitements : les corticoïdes, les immunosuppresseurs et les biothérapies qui peuvent être donnés séparément ou en combinaison », explique le Dr Jean-Jacques Raynaud, praticien hospitalier et responsable de l’unité d’endoscopie digestive à l’hôpital Avicenne AP-HP.
Si les corticoïdes sont souvent privilégiés dans un premier temps, il n’est pas recommandé de les utiliser sur une longue durée, en raison d’effets indésirables dus au traitement de long terme. Ils peuvent toutefois constituer un traitement d’attaque efficace, en attendant que les traitements de fond fassent effet. Pour certains patients souffrant de formes sévères de la maladie en échec thérapeutique ou présentant des complications, la chirurgie peut être proposée. C’est le cas de Tiphany Dalli-Verrecchia, qui a déjà subi 9 interventions chirurgicales depuis son diagnostic.
Parmi les biothérapies les plus utilisées, les anti-TNFα ont permis depuis 30 ans un grand pas en avant. Ces thérapies bloquent spécifiquement certaines voies de l’inflammation impliquées dans la maladie, les TNFα, de petites protéines produites par des cellules du système immunitaire.
Depuis plusieurs années, de nouvelles biothérapies ciblant d’autres voies de l’inflammation ont été développées, élargissant considérablement l’arsenal thérapeutique.
« Avec l’anti-TNF infliximab, on a atteint un plateau en termes d’efficacité depuis la fin des années 1990. Néanmoins, au cours des 5 dernières années, on a réussi à développer de nouvelles molécules associées à une meilleure tolérance (ustékinumab et védolizumab notamment) et les recherches continuent afin de pouvoir proposer de nouvelles thérapies plus efficaces que l’infliximab ou efficaces chez les patients en échec thérapeutique, ou devenus résistants aux traitements disponibles », explique le Pr Laurent Peyrin-Biroulet, du département de gastro-entérologie du CHRU de Nancy.
Quelle alimentation privilégier ?
S’il n’existe pas d’aliments permettant le contrôle de la maladie ou prédisposant aux rechutes, l’alimentation peut dans certains cas être adaptée, avec un impact sur la qualité de vie. « Lorsque l’on parle de maladies inflammatoires de l’intestin, on a tendance à établir un lien avec l’alimentation, or, des dizaines de régimes décrits dans la littérature sont difficiles à évaluer. Une notion récente, qui semble pertinente, est celle d’un régime hypo-inflammatoire dans lequel on supprime les graisses saturées, en privilégiant la viande blanche et le poisson à la viande rouge, ainsi que les fibres alimentaires », souligne le Pr Yoram Bouhnik, gastro-entérologue à l’hôpital Beaujon AP-HP.
Par ailleurs, les fumeurs ont un risque deux fois plus élevé de développer la maladie. Le tabagisme est associé à une évolution de la maladie beaucoup plus sévère en termes de poussées, mais aussi à un recours plus fréquent aux traitements et aux interventions chirurgicales.
Au-delà de la prise en charge, un travail de sensibilisation important reste à faire pour lutter contre les idées reçues, alors que la maladie touche un nombre croissant d’individus. « Il existe encore beaucoup d’a priori chez des personnes qui pensent que j’exagère mes douleurs, car la maladie de Crohn est un handicap invisible. Les personnes en bonne santé ont tendance à croire que ce sont des maux de ventre classiques, mais ne peuvent pas imaginer l’intensité de ces douleurs et cette fatigue », conclut Tiphany Dalli- Verrecchia.
Recherche thérapeutique et accompagnement quotidien
La recherche thérapeutique dans le champ des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique est en plein essor. Parmi les axes prioritaires d’amélioration du quotidien des patients, figurent l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques, le développement de nouvelles voies d’administration, et l’optimisation des stratégies thérapeutiques existantes.
« Les progrès récents des biothérapies sont doubles : nouvelles molécules et voie d’administration à la maison. En effet les biothérapies étaient, le plus souvent, administrées par voie intraveineuse à l’hôpital ; les nouvelles sont en administration orale ou sous-cutanée. Même les anciennes adoptent une voie sous-cutanée. Enfin, des biothérapies toujours plus nombreuses seront bientôt disponibles (près de 13 dans les 2 ans à venir) avec parfois de nouvelles cibles. » Dr Jean-Jacques Raynaud
« Le diagnostic est parfois difficile à poser, d’autant que les symptômes peuvent être vagues. Beaucoup de médecins pensent qu’il s’agit d’une crise de stress ou d’une gastro‑entérite. »
Un diagnostic difficile à poser
Le diagnostic de la maladie de Crohn repose sur un faisceau d’arguments cliniques et paracliniques. Pris isolément, aucun des tests réalisés ne permet de porter le diagnostic. Les symptômes sont souvent peu spécifiques et peuvent être confondus avec ceux d’autres maladies.
« Le diagnostic est souvent difficile et trop tardif. La coloscopie sous anesthésie générale permet de visualiser et d’analyser par des biopsies l’inflammation du côlon et de la partie terminale de l’intestin grêle. Des examens de radiologie par IRM ou une capsule qui filme l’intestin grêle peuvent aussi être utilisés. Certains marqueurs sanguins permettent également de dépister l’inflammation », souligne le Dr Raynaud.
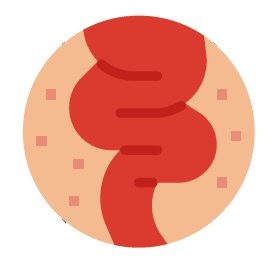 Comprendre le rôle du microbiote
Comprendre le rôle du microbiote
Les travaux de recherche sur l’impact en termes de santé du microbiote intestinal – qui contient 1012 à 1014 micro‑organismes, soit 2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps – sont en plein essor. Chez les patients atteints de MICI, des déséquilibres du microbiote en espèces bactériennes proinflammatoires et anti-inflammatoires, tout comme la prédominance de certaines familles de bactéries, ont été observés. Tout l’enjeu de la recherche est de mieux comprendre comment ces déséquilibres peuvent être résolus et quel impact cela pourrait avoir sur les patients. À l’heure actuelle, la greffe fécale, qui consiste à introduire les selles d’une personne saine dans le tube digestif d’un patient afin de reconstituer sa flore intestinale, semble avoir un effet limité sur les patients. « De nombreux travaux ont été menés sur le microbiote mais ils n’ont offert pour le moment aucun débouché clinique dans la maladie de Crohn. La greffe fécale a montré son efficacité pour des patients atteints de rectocolite hémorragique mais pas dans le cadre de la maladie de Crohn », explique le Pr Peyrin-Biroulet.
Quel impact sur la fertilité ?
La maladie de Crohn, qui diminue la fertilité, n’est pas aggravée par la grossesse mais cette dernière est souvent compliquée en cas de maladie active (fausse couche, prématurité, petit poids de naissance). « Pour cette raison, il est raisonnable de contrôler la maladie avant d’envisager une grossesse. Beaucoup de traitements autorisent la procréation. Certains ne permettent pas de grossesse ou nécessitent une adaptation des protocoles », explique le Dr Raynaud.
Par Léa Surugue
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry


