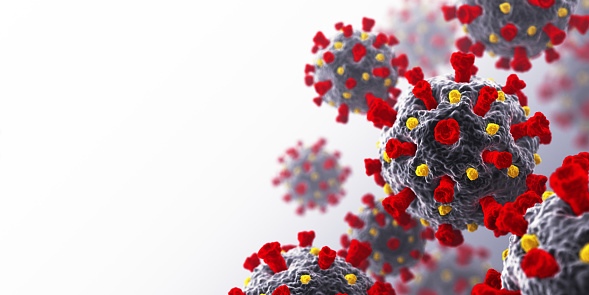Dans un rapport publié début avril, l’Académie nationale de médecine revient sur l’origine de la pandémie Covid. En analysant les preuves, bien qu’ils ne tranchent pas définitivement la question, les académiciens penchent plutôt pour une émergence due à une faute de manipulation du virus qu’à une provenance animale.
D’où vient le Covid-19 ? « Nous avons voté hier, et à 97 %, nous pensons que c’est plutôt une erreur de laboratoire », affirme le 3 avril le président de l’Académie nationale de médecine, Jean-Noël Fiessinger, lors de la conférence de presse dédiée à la publication d’un rapport sur le sujet.
Intitulé De l’Origine du SARS-CoV-2 aux risques de zoonoses et de manipulations dangereuses de virus, celui-ci ne manquera pas de faire parler. Jusqu’ici, deux hypothèses s’affrontent : le passage de l’animal à l’homme – thèse de la zoonose – versus la fuite d’un laboratoire de virologie. Quelle est la plus probable ?
Retour vers le passé
Cinq années se sont écoulées depuis la pandémie de Covid-19. Pourtant, l’origine du virus, qui a fait plus de 7 millions de morts, dont 168 000 en France, confirmés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – bien que des estimations poussent le compteur mondial à 20 millions de décès –, n’est toujours pas connue. En introduction, le rapport rappelle que « l’origine de ce virus jamais observé antérieurement reste non élucidée malgré de nombreuses recherches et enquêtes de terrain ».
Ce rapport fait suite à une séance plénière, aussi appelée « séance publique », de l’Académie nationale de médecine sur la question de l’origine du virus, en 2023. Elle fut suivie d’une année d’enquête par un groupe de travail composé de neuf scientifiques : virologues, épidémiologues, médecins. Le Pr Jean-François Delfraissy, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, était aussi de la partie.
« L’absence de consensus est pour le moment une évidence, rapporte Christine Rouzioux, professeur émérite de virologie, membre de l’académie et coordinatrice du rapport, lors de la conférence de presse. Nous pensons que c’est avec l’Europe qu’il faut en établir un ». Patrick Berche, professeur de microbiologie, également membre de l’académie, ajoute : « Tous ceux qui se penchent sur la thèse de l’accident [de laboratoire, ndlr] ne sont pas des complotistes. Ce sont ceux qui recherchent la vérité scientifique ».
Indice n’est pas preuve
À partir de quel faisceau d’indices l’Académie de médecine penche-t-elle plutôt pour la thèse de la fuite de laboratoire ? Bien qu’il n’y ait aucune preuve formelle pour l’une ou l’autre hypothèse rappelle-t-elle, certaines données sont troublantes.
D’abord, à ce jour, aucun animal intermédiaire, qui aurait été vecteur du virus, n’a été identifié avec certitude. Bien qu’une étude, publiée dans la revue scientifique Cell le 19 septembre 2024, a identifié les chiens viverrins et les civettes comme hôtes potentiels. Ces espèces étaient notamment présentes fin 2019 sur le marché de Huanan à Wuhan (Chine), épicentre de la pandémie.
Mais selon le rapport, « l’épidémie initiale s’est révélée très centralisée et liée à un virus de séquence très homogène, en contradiction avec un virus qui aurait circulé et qui aurait évolué au sein de réservoirs animaux ». De plus, Christine Rouzioux précise que « nous n’avons pas trouvé le virus dans la nature ni le virus ancestral. C’est un point qu’il faut vraiment continuer à explorer ». Qu’en est-il pour la fuite de laboratoire ?
En 2020, des chercheurs, dont Étienne Decroly, virologue faisant partie du groupe de travail du présent rapport, ont identifié une particularité au sein du génome de la souche virale initiale, dite « Wuhan ». Il s’agit d’un « site de clivage à la furine » : une petite séquence de quatre acides aminés insérée dans la séquence de la spike, formant les fameuses « couronnes » du virus. Or, ce type de séquence, connue pour augmenter la virulence et l’infectiosité, n’avait jamais été observée auparavant dans des protéines spike d’autres coronavirus.
Plutôt labo qu’animaux…
Ce qui fait pencher la balance suit. Une commission bipartisane de la chambre des représentants des États-Unis a établi que l’Institut de Virologie de Wuhan (WIV) menait des études de gain de fonction (gain of fuction, GOF), en collaboration avec des équipes américaines sur des coronavirus. Ces expériences « gain de fonction » consistent à modifier génétiquement un virus afin, entre autres, de comprendre les mécanismes de franchissement de barrière d’espèces.
« Selon ce rapport (celui des Américains, ndlr), le WIV programmait aussi des études de GOF sur des bétacoronavirus de chauve-souris distincts. Leur projet consistait en l’insertion de la séquence du site de clivage par la furine dans celle de la protéine spike de coronavirus, afin d’en étudier les conséquences sur l’infection de souris humanisées. », rend compte le rapport de l’Académie de médecine. Les auteurs émettent trois scénarios possibles : une contamination du personnel lors de la collecte d’échantillons, une contamination en laboratoire lors de l’étude d’un virus naturel, ou une contamination par un virus génétiquement modifié.
Enfin, en septembre 2019, quelques mois avant le début de la pandémie, les autorités chinoises ont supprimé l’accès à de nombreux fichiers informatiques, dont une base de données du WIV incluant des centaines de génomes viraux.
Reste que la question ne sera vraisemblablement pas tranchée de sitôt, et peut-être jamais, étant donné la quasi-impossibilité de trouver l’ultime preuve.
Un appel à la « culture des risques » en recherche biomédicale !
Deux types de risques existent. D’une part, des risques zoonotiques (transmission d’un pathogène de l’animal à l’humain) liés aux élevages intensifs, au trafic d’animaux sauvages et à la perte de biodiversité. D’autre part, des risques biologiques dus aux expériences de manipulation des virus. Face à ces menaces, le message principal du rapport de l’Académie nationale de médecine est un appel à la gestion des risques. « Nos recommandations ont l’objectif d’instaurer une culture d’évaluation des risques par une formation spécifique », précise la Pr Christine Rouzioux. L’académie appelle à renforcer les moyens techniques, financiers et humains pour coordonner les réseaux de surveillance de risque épidémique. Elle propose aussi de renforcer les règles de biosécurité des laboratoires manipulant des virus, avec la mise en place de « boîtes noires biologiques » (similaires à celles des avions) qui enregistreraient les faits et gestes des scientifiques. De plus, ces laboratoires devraient tous, selon les recommandations de l’Académie, procéder à l’ouverture de « Cellule éthique des recherches scientifiques à risque ». Ces incitations à la précaution auront-elles l’écho voulu dans les institutions de recherches ? Affaire à suivre.
Par Sacha Citerne
 Angry
Angry Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad