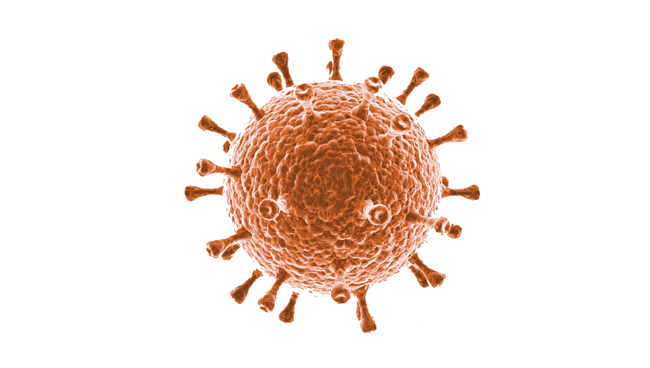En mars 2019, un deuxième cas mondial de rémission d’un patient atteint du virus du sida a été recensé. Même si la recherche avance, la découverte d’un traitement capable de guérir l’infection semble toujours lointaine. La prévention, quant à elle, reste plus que jamais indispensable.
Depuis sa découverte en 1983, les recherches sur le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ont largement évolué. En effet, le stade final de l’infection, appelé syndrome d’immunodéficience acquise (sida), est passé d’une maladie mortelle pendant les années 1980 à une maladie chronique à la fin des années 1990 pour les personnes ayant accès aux traitements, grâce à l’arrivée sur le marché des trithérapies. Celles-ci n’éliminent pas le virus, mais elles l’empêchent de se multiplier dans les cellules qui n’ont pas encore été infectées. Alors que les derniers chiffres indiquent que 36,9 millions de personnes vivent avec le virus du sida dans le monde, parmi elles, seulement 59 % ont accès aux traitements.
Les patients de Londres et Berlin
Les deux cas de rémission avaient tous deux développé des cancers du sang pour lesquels ils ont été traités par des greffes de moelle osseuse. Timothy Brown, connu sous le nom de « patient de Berlin », a reçu une greffe de moelle osseuse en 2008, à la suite de laquelle il a arrêté son traitement. Depuis, la présence du virus dans le sang est devenue indétectable. Le nouveau cas, le « patient de Londres », est, quant à lui, en rémission depuis plus d’un an.
Une procédure à haut risque
Si ces résultats sont de bon augure pour la prise en charge des personnes séropositives, il ne s’agit pas d’une méthode de traitement reproductible à grande échelle. Comme le souligne Asier Sáez-Cirión, chercheur à l’Institut Pasteur : « Il s’agit d’une procédure extrêmement lourde associée à un taux de mortalité très élevé. Elle est proposée à des patients souffrant de cancers du sang pour qui cette greffe représente le traitement de la dernière chance. » Si la greffe n’est pas rejetée, les cellules immunitaires du donneur vont alors détruire les cellules infectées par le VIH.
Rémission ne signifie pas guérison
Au total, Asier Sáez-Cirión précise qu’il y a eu « plusieurs dizaines de patients ont reçu des greffes de moelle osseuse. Quasi systématiquement, on retrouve une diminution très importante du nombre de cellules infectées, jusqu’à devenir indétectables. »
Toutefois, si le virus devient indétectable dans le sang, il peut rester en dormance dans d’autres cellules de notre corps.
De ce fait, parmi les patients greffés ayant interrompu leur traitement antirétroviral, certains ont vu un rebond du nombre de cellules infectées plusieurs mois ou plusieurs années après : « c’est pour cette raison que l’on parle de période de rémission et non de guérison », ajoute le scientifique.
Une mutation génétique résistante au virus
Les patients de Londres et Berlin sont des cas particuliers. En effet, les donneurs présentaient des mutations génétiques au niveau de l’un des récepteurs d’entrée du VIH, limitant l’entrée du virus dans les cellules. « Dans ce cas, la greffe va, d’une part, diminuer le nombre de cellules infectées et, d’autre part, conférer une résistance au virus grâce aux nouvelles cellules immunitaires », explique le chercheur. Cette mutation est très inégalement distribuée dans le monde. Elle est relativement fréquente dans les populations du nord de l’Europe (de 6 à 15 %) et quasi absente des populations d’Afrique, par exemple.
La prévention : meilleure arme contre l’épidémie
Les chiffres les plus récents estiment que plus d’un million de personnes sont infectées par le VIH chaque année, la prévention reste donc un enjeu majeur aujourd’hui. Selon Asier Sáez-Cirión, « une guérison complète des patients semble un objectif compliqué à atteindre à l’heure actuelle. En revanche, nous avons les outils de prévention nécessaires pour éradiquer l’épidémie. »
Au final, pour le chercheur, « dans cette lutte, la barrière la plus importante est sociale et politique : il faut décupler l’accès à ces outils de prévention partout dans le monde et lutter contre la discrimination et la stigmatisation envers les populations séropositives et celles les plus à risque d’être contaminées par le VIH. »
La PrEP: un nouvel outil de prévention
Depuis 2015, une nouvelle méthode de prévention contre le VIH est arrivée en France : connue sous le nom de PrEP (Prophylaxie préexposition), elle s’adresse aux personnes qui n’ont pas le VIH, afin d’éviter une contamination en empêchant le virus d’entrer dans le corps. Son utilisation est recommandée pour les personnes séronégatives n’utilisant pas systématiquement de préservatif et appartenant à des populations très exposées au virus du Sida. Les premières données montrent que, lorsque le médicament est bien pris, le risque de contamination est infime.
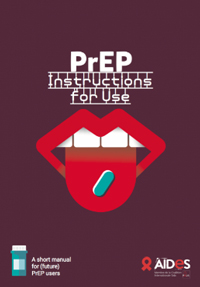
Pour en savoir plus : la PrEP, mode d’emploi sur le site d’Aides. www.aides.org/prep
Par Julie Desriac
 Haha
Haha Heart
Heart Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry