Selon un sondage Ifop datant de novembre 2020, 22 % des 18-30 ans ne se sentent ni homme ni femme. « Non binaire », « gender fluid », ces nouveaux mots arrivent désormais dans notre quotidien, avec notamment l’apparition du pronom « iel » dans le Petit Robert. Mais il n’est pas toujours simple de définir et comprendre ces termes.
Glossaire
Cisgenre (ou cis) : personne dont l’identité de genre correspond au sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance.
Coming-out : le coming out désigne l’annonce volontaire d’une orientation sexuelle ou d’une identité de genre à son entourage. « Outer » une personne, c’est faire son coming out à sa place.
Dysphorie de genre : sentiment d’inadéquation entre son genre assigné à la naissance et son identité de genre.
 Genderfluid : il s’agit d’une personne dont le genre peut osciller entre tous les genres (homme, femme, non-binaire, binaire), de manière prévisible ou non, selon les périodes et situations de sa vie.
Genderfluid : il s’agit d’une personne dont le genre peut osciller entre tous les genres (homme, femme, non-binaire, binaire), de manière prévisible ou non, selon les périodes et situations de sa vie.
Genre : catégorisation sociale et psychologique qui divise les êtres humains entre masculin et féminin.
Identité de genre : identité masculine ou féminine (ou les deux ou aucune des deux) qu’une personne se construit tout au long de sa vie.
Mégenrer : attribuer le mauvais genre à une personne.
Neutre : personne dont le genre intègre des éléments perçus comme masculins et d’autres perçus comme féminins, mais dont on a retiré toute conception de genre.
 Non-binaire : personne dont le genre n’est ni exclusivement féminin ni exclusivement masculin. Une personne peut se sentir soit un homme et une femme, soit ni l’un ni l’autre, soit l’un ou l’autre.
Non-binaire : personne dont le genre n’est ni exclusivement féminin ni exclusivement masculin. Une personne peut se sentir soit un homme et une femme, soit ni l’un ni l’autre, soit l’un ou l’autre.
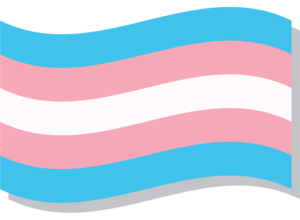 Transgenre (ou trans) : personne dont l’identité de genre ne correspond pas avec le sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance.
Transgenre (ou trans) : personne dont l’identité de genre ne correspond pas avec le sexe biologique qui lui a été assigné à la naissance.
Le genre
Avant de commencer, partons de la base et définissons ensemble le genre. Arnaud Alessandrin, sociologue à l’université de Bordeaux et spécialiste des questions de genre, de santé et de discrimination, définit le genre « est une assignation à la naissance. On ne le choisit pas, ce sont les codes sociaux de répartition binaire, qui nous endiguent dans des devenirs homme ou femme. » Il est très important de différencier le sexe et le genre. Le sexe est une catégorie qui divise les êtres humains entre les hommes et les femmes, sur la base de leur anatomie et de leur physiologie. Si on a un pénis, on est un garçon, et si on a une vulve, on est une fille. Et en fonction du sexe, bon nombre de stéréotypes l’accompagne.
Une construction sociale
Pour Judith Butler, philosophe américaine, Simone de Beauvoir ou encore Margaret Mead, anthropologue américaine, le genre n’est pas anatomique, mais social. C’est la société qui le construit et le fait évoluer, avec les attentes mentales, mais aussi les représentations et les imaginaires, les discours (scientifiques, médiatiques), qui participent pleinement à cette bi-catégorisation. Pourtant, cette binarité n’est pas actée partout. En effet, dans certaines sociétés, il y a trois, quatre, voire même cinq genres. C’est le cas par exemple en Indonésie, en Polynésie, au Pakistan ou encore au Mexique.
Briser la binarité
Cette binarité homme-femme, ne convient plus. Et si la société est responsable des stéréotypes de genre, elle est aussi, depuis quelques années, en train de faire bouger les choses. « Ce qui a fait évoluer cette notion-là, c’est d’abord les propositions théoriques qui se sont progressivement extirpées du fatalisme biologique du sexe », explique Arnaud Alessandrin. Comme le dit si bien Simone de Beauvoir « on ne naît pas femme, on le devient ». Et oui, la nature ne fait pas tout !
Plus récemment, des courants de pensées propres aux genres – les gender theory – ainsi que les mouvements militants, comme le féminisme ou les mouvements LGBTQIA+, ont développé un sens critique concernant les assignations de sexe et de genre. « Ils sont, aujourd’hui, le fer de lance de cette déconstruction du genre », précise le sociologue bordelais. Grâce aux réseaux sociaux, les personnes témoignent de leur vécu en disant « je », et par conséquent, raconte leur histoire directement, sans passer par le prisme de l’école ou de la famille. Aussi, le fait que les réseaux sociaux soient des interfaces qui nécessitent du visuel (photos, vidéos…) et du texte permet de créer une culture commune autour de cette notion de non-binarité du genre. Et cette culture commune, se construit aussi bien avec les personnes qui se sentent directement concernées, qu’avec le grand public. Les réseaux ont également le pouvoir de briser l’isolement et permettre aux gens de se rencontrer ou de créer des mouvements sociaux, du militantisme, des demandes de reconnaissance ou des interpellations publiques.
 Si ces représentations sont également amenées à changer, c’est parce que désormais, les récits sont incarnés et les gens se sentent davantage représentés. On le voit notamment à travers les séries, comme Heartstopper, Orange is the new black, Grey’s Anatomy ou Umbrella Academy par exemple. « Si on prend les séries qui datent, comme The L world ou Queer as folk, les personnes trans, étaient soit inexistantes, soit marginales. Aujourd’hui, on assiste, dans ces arcs narratifs, à une plus grande visibilité et aussi à une banalisation. On n’a plus besoin de s’arrêter sur la souffrance, la transition ou encore la génitalité. »
Si ces représentations sont également amenées à changer, c’est parce que désormais, les récits sont incarnés et les gens se sentent davantage représentés. On le voit notamment à travers les séries, comme Heartstopper, Orange is the new black, Grey’s Anatomy ou Umbrella Academy par exemple. « Si on prend les séries qui datent, comme The L world ou Queer as folk, les personnes trans, étaient soit inexistantes, soit marginales. Aujourd’hui, on assiste, dans ces arcs narratifs, à une plus grande visibilité et aussi à une banalisation. On n’a plus besoin de s’arrêter sur la souffrance, la transition ou encore la génitalité. »
Gender fluid : la mouvance des genres
Le terme gender fluid permet d’exprimer de manière plus fine, la nonbinarité d’une personne. Selon le sociologue Bordelais, être gender fluid « renvoie à l’idée qu’on puisse être, de manière alternative dans notre vie, Gender fluid : la mouvance des genres n’importe quel genre. En sommes, quelque chose de moins fixe que le sexe ou le genre assigné ». Être gender fluid, « c’est pouvoir changer, pouvoir ne pas choisir ou être entre les deux. Une personne peut sentir soit un homme et une femme, soit ni l’un ni l’autre, soit l’un ou l’autre. »
Si on prend un exemple parlant, celui de Bilal Hassani, il apparaît tantôt avec des perruques, du maquillage, en robes et talons, et tantôt avec un style vestimentaire plus masculin. Il oscille donc entre le féminin et le masculin, et se sent bien dans les deux genres. Pour d’autres, ils se sentiront soit masculin ou féminin et puis d’autres, aucun des deux.
Le mot d’Élise Blanc,
 psychologue clinicienne – psychothérapeute à Lorient
psychologue clinicienne – psychothérapeute à Lorient
Comment préparer l’entourage ?
En général, le coming out trans, arrive après plusieurs années, voire dizaines d’années de réflexion et de maturation. Certaines personnes trans commencent à s’interroger vers 5-6 ans, ce n’est donc pas une décision prise sur un coup de tête, c’est un long cheminement. Cela peut aussi s’accompagner d’incompréhensions du monde extérieur dans lequel la personne ne se retrouve pas, et de honte. Lorsque quelqu’un annonce sa transidentité à son entourage, celui-ci doit : comprendre, intégrer et accepter en quelques minutes, une réflexion de plusieurs années.
Ensuite l’entourage doit apprendre un nouveau vocabulaire, une nouvelle grammaire, nommer et parfois genrer autrement la personne qui vient de faire son coming out trans. C’est beaucoup ! C’est pour cela qu’il faut comprendre que la réaction des proches peut être brutale, car ils n’ont pas atteint ce même niveau de maturité et qu’il faut aussi leur laisser du temps. Si pour certains il y a un soulagement de comprendre le mal-être de l’enfant, pour ceux qui n’ont rien vu venir et qui ne sont pas préparés, cela peut être un véritable choc.
C’est pour cela que je conseille aux personnes gender fluid de commencer à donner des indices, d’être pédagogues, et de faire une annonce fluide dans le temps, afin de laisser un temps de préparation et de maturation aux parents qui vont devoir apprendre à voir le monde autrement, que de façon binaire.
Pour les parents, la transition est plus facilement acceptable lorsqu’elle est binaire, le gender fluid n’est pas forcément compris du fait de la perte des repères binaires. Par exemple, si une fille se sent plutôt garçon, c’est clair, mais si elle est gender fluid, qu’elle ne définit pas ce qu’elle est, pour eux c’est plus compliqué. Je conseille souvent aux parents d’avoir un lieu pour parler. Je les oriente vers l’association qui s’appelle contact.org qui est une association d’écoute, qui va pouvoir répondre aux parents, à leurs inquiétudes et leurs questions. Il existe également des groupes de parole.
Les conseils pour les parents
Je voudrais vraiment souligner que le gender fluid existe depuis la nuit des temps et que ce n’est pas une mode. Non, ce n’est pas “une passade”, non ce n’est pas en voyant un documentaire sur le sujet que l’enfant s’est dit “tiens, si je devenais trans”.
Le soutien parental fort est fondamental au développement harmonieux de l’enfant. À ce stade de développement, il est particulièrement sensible au rejet/acceptation par les personnes importantes. Une fois le coming out fait, il est nécessaire de prendre le temps de rééquilibrer la famille, que chacun retrouve sa nouvelle place et que les parents fassent le deuil de leurs projections sur leur enfant. En effet, ce qui est compliqué pour les parents, c’est faire le deuil de ce qu’a été leur enfant, pour accueillir finalement un autre enfant, en construction, car la transition peut durer tout une vie. L’adaptation peut se faire à des rythmes différents et déclencher des conflits intrafamiliaux, c’est pourquoi il faut respecter le rythme de chacun.
« Il y a une différence entre “ne pas être d’accord” et “obliger son enfant à ne pas faire ce qu’il veut ”. »
Il ne faut pas « outer » quelqu’un qui n’est pas prêt, il ne faut pas non plus accélérer la transition, il est nécessaire de laisser l’enfant évoluer en fonction de son ressenti, de ses envies. Aussi, ce genre fluide ou cette transition ne va pas définir l’enfant, il n’est pas QUE ça et il ne faut pas que cela devienne le coeur des conversations ! Il faut suivre le rythme de l’enfant, ne pas l’enfermer dans sa transidentité, lui laisser prendre le temps de trouver ses marques. Même si cela peut être compliqué au début, il faut essayer de genrer comme la personne le demande, d’utiliser un autre prénom si elle le souhaite, utiliser un vocabulaire commun, et la laisser évoluer à son rythme.
 Les parents ont le droit de ne pas être d’accord, mais on peut s’entendre et ne pas être d’accord. C’est-à-dire qu’il y a une différence entre « ne pas être d’accord » et « obliger son enfant à ne pas faire ce qu’il veut ». D’autant que, bien souvent, les enfants sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents, parce qu’ils se disent « j’aime mon parent, mais je ne suis pas tel qu’il veut que je sois. »
Les parents ont le droit de ne pas être d’accord, mais on peut s’entendre et ne pas être d’accord. C’est-à-dire qu’il y a une différence entre « ne pas être d’accord » et « obliger son enfant à ne pas faire ce qu’il veut ». D’autant que, bien souvent, les enfants sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leurs parents, parce qu’ils se disent « j’aime mon parent, mais je ne suis pas tel qu’il veut que je sois. »
« Ce n’est pas la transidentité qui amène à la marginalisation, c’est la réaction de l’entourage qui va amener à l’isolement, le fait de se sentir coincé, pas compris et parfois stigmatisé par la société. »
Aussi, les parents n’ont pas besoin d’adhérer à tout prix à ce qui se passe, mais ils doivent tout de même défendre les droits de leur enfant, que ce soit à l’école, ou auprès des autres personnes qui jugent ou discriminent l’enfant. Ce n’est pas la transidentité qui amène à la marginalisation, c’est la réaction de l’entourage qui va amener à l’isolement, le fait de se sentir coincé, pas compris et parfois stigmatisé par la société. Il y a beaucoup d’agressivité de la part de l’extérieur aussi. C’est pourquoi je conseille souvent aux parents de s’entourer de personnes qui ne vont pas être dans le jugement. Pour faire simple, il faut viser la sécurité, le bien-être de l’enfant, l’attention et surtout gérer tous les préjugés.
L’association Contact
L’association Contact a pour objectifs d’aider l’entourage à comprendre et accepter l’orientation sexuelle et/ ou l’identité de genre de leurs proches. Elle s’adresse également au personnes gays, bi, trans, à communiquer avec leurs parents et ami·e·s en leur apportant la compréhension nécessaire pour s’accepter. L’association se bat aussi contre les discriminations dont les personnes LGBTQIA+ peuvent être victimes. Aujourd’hui, elle regroupe un réseau d’une vingtaine d’associations, avec plus de 600 adhérent·e·s et plus de 200 bénévoles. Elle dispose d’un centre d’écoute anonyme et gratuit, qui s’adresse aux parents, familles et ami·e·s, aux personnes LGBTQIA+ et tous ceux qui se sentent concerné·e·s.
 Numéro : 0 805 69 64 64
Numéro : 0 805 69 64 64
Horaires :
Du lundi au jeudi : 17h00 -21h00
Vendredi 15h00-20h00
Samedi 13h30-15h30
https://www.asso-contact.org/
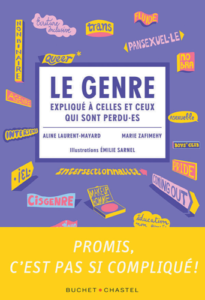 Pour aller plus loin, la rédaction de Vocation Santé vous recommande l’ouvrage Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·e·s. Écrit par Marie Zafimehy et Aline Laurent-Mayard, cet ouvrage permet de mieux comprendre tous les termes qui bouleversent notre société : « non-binaire », « gender fluid », « cisgenre », « LGBTQIA+ »… La pédagogie et la clarté de ce livre, vous donneront toutes les clés en main pour répondre à vos questionnements. Grâce aux différentes définitions, aux recommandations (comptes réseaux sociaux, films, documentaires), les questions LGBTQIA+ n’auront plus de secret pour vous.
Pour aller plus loin, la rédaction de Vocation Santé vous recommande l’ouvrage Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdu·e·s. Écrit par Marie Zafimehy et Aline Laurent-Mayard, cet ouvrage permet de mieux comprendre tous les termes qui bouleversent notre société : « non-binaire », « gender fluid », « cisgenre », « LGBTQIA+ »… La pédagogie et la clarté de ce livre, vous donneront toutes les clés en main pour répondre à vos questionnements. Grâce aux différentes définitions, aux recommandations (comptes réseaux sociaux, films, documentaires), les questions LGBTQIA+ n’auront plus de secret pour vous.
Édition Buchet-Chastel, 320 pages, 19,50 €.
Par Mélanie Philips
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry


