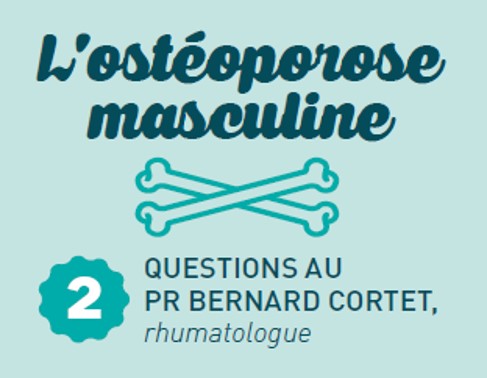Qu’est-ce que l’ostéodensitométrie ?
Il s’agit d’un examen simple permettant de mesurer la densité minérale osseuse, c’est-à-dire la « quantité d’os » d’une personne.
Le principe est le suivant : lorsqu’un faisceau d’énergie traverse un corps solide, une partie de cette énergie est absorbée. Or, la quantité absorbée est d’autant plus grande que le corps traversé a une densité élevée.
Ainsi, pour apprécier la densité de l’os, il suffit de faire passer à travers le corps une certaine quantité d’énergie et de mesurer la quantité d’énergie qui en ressort. À l’aide d’une simple soustraction, on obtient alors la quantité absorbée au niveau de l’os permettant d’évaluer la « densité », c’est-à-dire la qualité de minéralisation de l’os.
Dans quel cadre est-elle pratiquée ?
C’est votre médecin qui décidera de vous faire passer ou non une ostéodensitométrie.
Cet examen est utile lorsqu’on soupçonne une ostéoporose – c’est-à-dire en cas de survenue d’un tassement vertébral ou d’une fracture pour un choc minime ou en présence de facteurs de risque – et si vous êtes une femme après la ménopause en présence de certains facteurs de risque.
Toutefois, si vous suivez un traitement hormonal substitutif (THS) à la dose efficace pour éviter l’apparition d’une ostéoporose, cet examen est inutile.
Une fois l’ostéoporose diagnostiquée, l’intérêt de l’ostéodensitométrie dans le suivi, pour apprécier l’efficacité du traitement prescrit, est plus difficile à apprécier. En règle générale, seules des variations de 3 à 5 % par rapport aux examens précédents sont retenues.
Dans tous les cas, cet examen ne doit pas être répété avant 2 ou 3 ans, car les modifications de la densité sont lentes.
Est-elle remboursée ?
Depuis le décret du 29 juin 2006, l’ostéodensitométrie est remboursée par la Sécurité sociale sous certaines conditions.
Le premier examen est remboursé lorsque les résultats ont une implication dans la prise en charge, c’est-à-dire s’ils entraînent la mise en route d’un traitement. Ainsi, le remboursement est acquis si une des conditions suivantes est remplie :
- Si vous avez déjà une fracture vertébrale ou périphérique, même ancienne.
- Si vous présentez une maladie ou un traitement qui entraîne un risque élevé de survenue d’ostéoporose.
- Si vous avez une ménopause précoce (avant 40 ans).
- Si vous présentez des facteurs de risque d’ostéoporose.
- Si vous avez un indice de masse corporelle < 19 kg/m2.
- Si l’un de vos parents du 1er degré a présenté une fracture du col fémoral.
Pour les examens ultérieurs, le remboursement est également possible lorsque le traitement instauré a été arrêté ; il en est de même si vous êtes ménopausée et que votre premier examen était normal, si votre médecin vous prescrit une 2e ostéodensitométrie 3 à 5 ans plus tard.
Comment se déroule-t-elle ?
L’ostéodensitométrie est un examen très simple et totalement indolore. Elle ne nécessite aucune injection et aucun prélèvement. Il suffit de vous allonger sur une table de radiologie et de rester immobile quelques minutes.
Cet examen ne pourra pas être pratiqué si vous êtes enceinte. Il ne sera pas non plus réalisé si vous avez eu, 2 ou 3 jours avant, une scintigraphie osseuse ou un examen du tube digestif pour lequel vous avez pris un produit de contraste comme la baryte.
Quels sont les résultats ?
La mesure s’effectue généralement sur deux sites : le rachis lombaire et la hanche (région du col du fémur). Le résultat reflète la densité osseuse et s’exprime en gramme par centimètre carré.
Une fois calculée, la densité osseuse est comparée à celle d’une population d’adultes jeunes. La différence entre la mesure réalisée chez un individu et la moyenne dans cette population est ce qu’on appelle le T-score. En terme statistique, cette valeur est exprimée en nombre d’écarts-types. C’est à partir de ce chiffre que l’Organisation mondiale de la santé a défini l’ostéoporose, selon les grades suivants :
- Normal : T-score supérieur à – 1 écart-type.
- Ostéopénie (baisse de la densité osseuse précédant l’ostéoporose) : T-score compris entre – 1 et – 2,5 écarts-types.
- Ostéoporose : T-score inférieur à – 2,5 écarts-types.
- Ostéoporose sévère : T-score inférieur à – 2,5 écarts-types et présence d’une ou plusieurs fractures.
Une autre valeur figurant sur les comptes rendus d’ostéodensitométrie est le Z-score. Ici, il s’agit de la différence entre la mesure réalisée chez l’individu et la moyenne des sujets du même groupe d’âge.
Caroline Sandrez
L’ostéoporose de l’homme est-elle la même que celle de la femme ?
Des similitudes existent, mais également un grand nombre de différences.
- Fréquence moindre (15 % versus 40 % chez la femme), en raison du volume osseux beaucoup plus important chez l’homme, et de l’absence d’un équivalent à la ménopause de la femme.
- Facteurs de risque plus nombreux (tabac, alcool, prise de cortisone, baisse de la testostérone, etc.) majorant la gravité de l’affection.
- Risques accrus d’une ostéoporose de type secondaire (> 50 % des cas) à une atteinte digestive, hématologique, ou endocrinienne responsable de la fragilité osseuse.
- Risque de fracture majoré en cas de chute, surtout après 70 ans.
- Gravité majorée des fractures, survenant souvent sur un terrain fragilisé en raison de comorbidités fréquentes.
- Incidence plus forte de la mortalité à 5 ans (51 % vs 39 % chez la femme), multipliée par 2 en cas de fracture de la hanche.
Existe-t-il un examen spécifique de dépistage pour l’homme ?
Chez l’homme, comme chez la femme, le seuil densitométrique est le même (T-score ≤ – 2,5), mais la mesure doit se faire de manière préférentielle à la hanche, moins sujette aux remaniements osseux que les vertèbres lombaires. Il n’existe pas d’examen spécifique de dépistage chez l’homme ; toutefois, en raison de la fréquence des causes d’ostéoporose secondaire, la recherche de celles-ci et des facteurs de risque doit être systématique. En l’absence d’éléments d’orientation, on peut pratiquer un dosage de testostérone, ou évaluer la charge en fer, à la recherche d’une hémochromatose.
Bon à savoir
- Bien qu’il s’agisse d’émission de rayons X, l’irradiation est très faible et représente environ 1/10e de la dose délivrée au cours d’une radiographie des poumons.
- Différents termes désignent le même examen : densitométrie osseuse, absorptiométrie biphotonique, DXA ou DEXA (pour Dual Energy X-Ray Absorpsiometry).
Quelques chiffres
40 % des femmes et 15 % des hommes : c’est la proportion de sujets de plus de 50 ans qui seront un jour ou l’autre concernés par la survenue d’une fracture ostéoporotique.
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry