Selon une étude du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, les utilisateurs de jeux vidéo représentaient, en 2020, plus de 60 % de la population française. Néanmoins, depuis des années, on n’a cessé de pointer du doigt les effets néfastes des jeux vidéo. En fait, tout dépend du type de jeu.
Les jeunes qui jouent sont de mauvais élèves
![]() Il se pourrait même que, dans certains cas, l’effet soit inverse. D’après une étude de la Royal Melbourne Institute of Technology de 2016, les jeux vidéo auraient un effet positif sur les notes en mathématiques, en lecture et en sciences. Au contraire, la
Il se pourrait même que, dans certains cas, l’effet soit inverse. D’après une étude de la Royal Melbourne Institute of Technology de 2016, les jeux vidéo auraient un effet positif sur les notes en mathématiques, en lecture et en sciences. Au contraire, la  fréquentation des réseaux sociaux aurait l’effet inverse. Un effet qui ne surprend pas les chercheurs. De nombreux jeux vidéo encouragent la réflexion, à travers des mécaniques de stratégie ou d’exploration. D’autres études moins optimistes estiment que les jeux auraient juste peu, voire aucun effet sur les résultats scolaires des adolescents. Pas de quoi s’inquiéter donc.
fréquentation des réseaux sociaux aurait l’effet inverse. Un effet qui ne surprend pas les chercheurs. De nombreux jeux vidéo encouragent la réflexion, à travers des mécaniques de stratégie ou d’exploration. D’autres études moins optimistes estiment que les jeux auraient juste peu, voire aucun effet sur les résultats scolaires des adolescents. Pas de quoi s’inquiéter donc.
Ils peuvent rendre les jeunes accros
 L’addiction aux jeux vidéo est même reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une maladie mentale depuis 2018. Cependant, tous les jeux ne posent pas ce problème de dépendance. Sont principalement mis en cause les free to
L’addiction aux jeux vidéo est même reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une maladie mentale depuis 2018. Cependant, tous les jeux ne posent pas ce problème de dépendance. Sont principalement mis en cause les free to  play, dont le modèle économique nourrit le caractère addictif du jeu. Le joueur n’achète plus le jeu en lui-même mais paie, au sein du jeu, pour débloquer des améliorations qui sont bien souvent distribuées aléatoirement. L’objectif : transformer le divertissement en jeu de hasard et garder le joueur connecté le plus longtemps possible.
play, dont le modèle économique nourrit le caractère addictif du jeu. Le joueur n’achète plus le jeu en lui-même mais paie, au sein du jeu, pour débloquer des améliorations qui sont bien souvent distribuées aléatoirement. L’objectif : transformer le divertissement en jeu de hasard et garder le joueur connecté le plus longtemps possible.
Prudence néanmoins : le terme d’addiction est réservé aux cas de déscolarisation ou de désocialisation complète depuis plus de 12 mois. Il concerne environ 0,5 % à 4 % du nombre de joueurs mondial.
Les jeux seraient mauvais pour la santé mentale
![]() En 2021, une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, a montré que les jeux vidéo sont en fait bénéfiques pour la santé mentale. Pour cela, ils se sont servis des temps de jeu fournis par deux
En 2021, une étude menée par des chercheurs de l’Université d’Oxford, a montré que les jeux vidéo sont en fait bénéfiques pour la santé mentale. Pour cela, ils se sont servis des temps de jeu fournis par deux 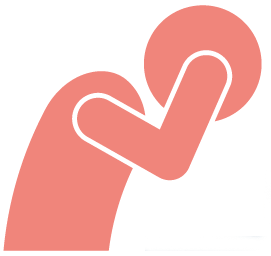 grands éditeurs vidéoludiques et d’un questionnaire posé à 3 274 joueurs. Les scientifiques ont ainsi compris que ce sont avant tout les expériences vécues pendant le jeu qui sont associées à un effet positif sur la santé mentale. D’autres études révèlent également que le jeu en ligne peut être un fort vecteur de socialisation.
grands éditeurs vidéoludiques et d’un questionnaire posé à 3 274 joueurs. Les scientifiques ont ainsi compris que ce sont avant tout les expériences vécues pendant le jeu qui sont associées à un effet positif sur la santé mentale. D’autres études révèlent également que le jeu en ligne peut être un fort vecteur de socialisation.
Le jeu vidéo peut être utile en thérapie
 Selon certains thérapeutes, ces dispositifs vidéoludiques, en plus de leurs effets cathartiques, peuvent être de véritables outils thérapeutiques. Jamais comme outil principal de guérison du patient, mais surtout comme un support de thérapie. À la différence des autres médias, dans un jeu vidéo, le joueur est au centre de l’action. Le jeu offre au patient grâce aux pseudonymes
Selon certains thérapeutes, ces dispositifs vidéoludiques, en plus de leurs effets cathartiques, peuvent être de véritables outils thérapeutiques. Jamais comme outil principal de guérison du patient, mais surtout comme un support de thérapie. À la différence des autres médias, dans un jeu vidéo, le joueur est au centre de l’action. Le jeu offre au patient grâce aux pseudonymes  et aux personnages qu’il choisit, la possibilité d’incarner et de dévoiler ses états intérieurs. Un intermédiaire bien utile au thérapeute lorsqu’il traite un patient qui peine à tisser du lien social. Les jeux vidéo rendent la thérapie à la fois plus ludique et plus active qu’une consultation traditionnelle.
et aux personnages qu’il choisit, la possibilité d’incarner et de dévoiler ses états intérieurs. Un intermédiaire bien utile au thérapeute lorsqu’il traite un patient qui peine à tisser du lien social. Les jeux vidéo rendent la thérapie à la fois plus ludique et plus active qu’une consultation traditionnelle.
Ils permettent également de simuler des situations stressantes pour traiter les phobies par exemple. Le jeu vidéo est même utilisé dans la prévention contre les maladies neurodégénératives. Ces nouveaux jeux pédagogiques ou médicaux sont regroupés sous le terme de serious games.
Le saviez-vous ?
 Une étude menée cette année, par des chercheurs du Karolinska Institutet en Suède, a mis en évidence que les jeux vidéo rendraient plus intelligent. Ils ont évalué, sur 5 000 enfants américains, la corrélation entre les habitudes en matière d’écrans et l’évolution de leurs capacités cognitives. Le tout sur une période de 2 ans. Leur publication révèle que les jeunes qui jouaient le plus, avaient vu leur “intelligence” augmenter légèrement. En particulier en comparaison des enfants dont l’attitude vis-à-vis des écrans était passive : télévision et réseaux sociaux.
Une étude menée cette année, par des chercheurs du Karolinska Institutet en Suède, a mis en évidence que les jeux vidéo rendraient plus intelligent. Ils ont évalué, sur 5 000 enfants américains, la corrélation entre les habitudes en matière d’écrans et l’évolution de leurs capacités cognitives. Le tout sur une période de 2 ans. Leur publication révèle que les jeunes qui jouaient le plus, avaient vu leur “intelligence” augmenter légèrement. En particulier en comparaison des enfants dont l’attitude vis-à-vis des écrans était passive : télévision et réseaux sociaux.
Par Alexandre Morales
 Heart
Heart Yay
Yay Haha
Haha Wow
Wow Angry
Angry Sad
Sad


