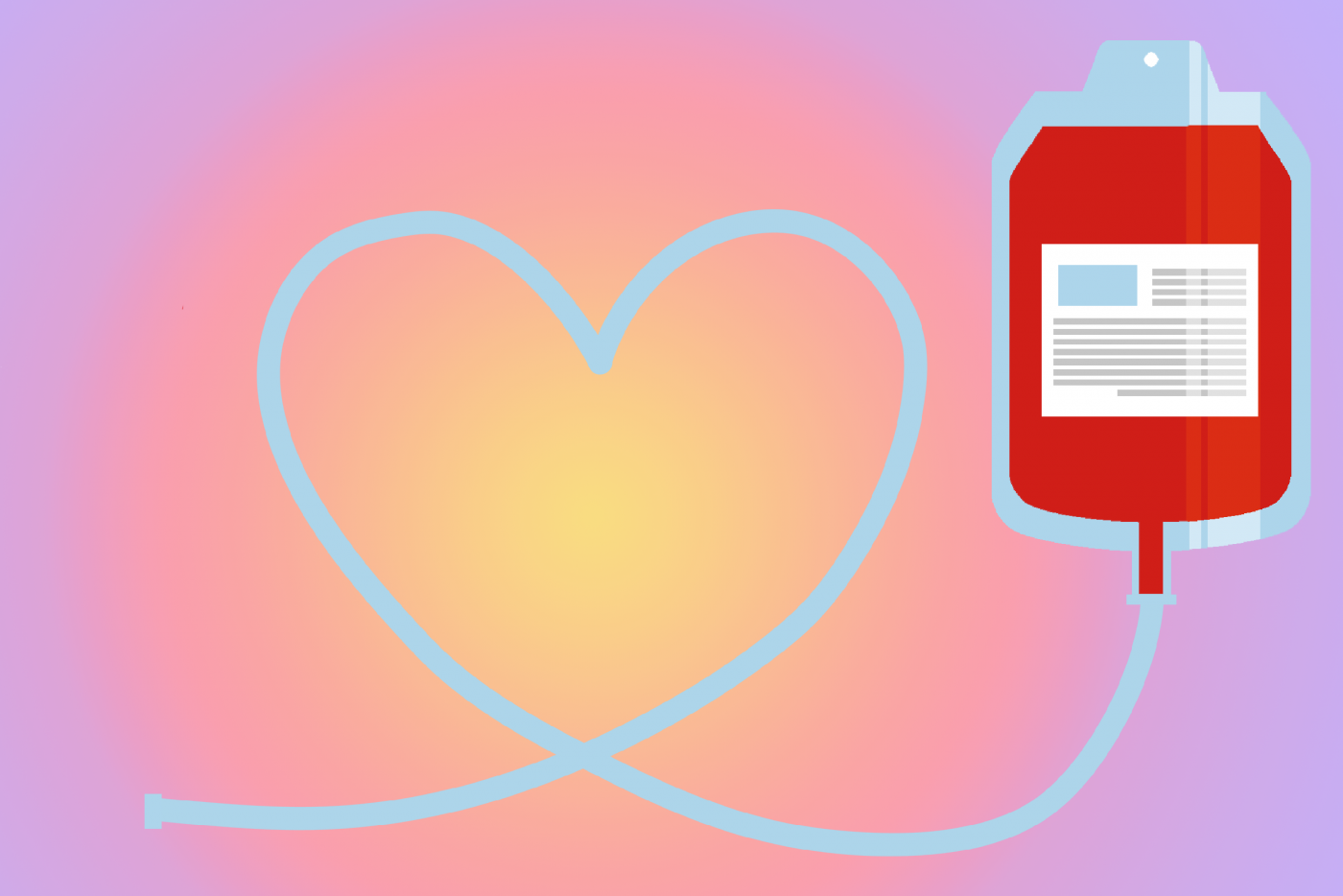Donner son sang est une action citoyenne et solidaire. À compter du mois de mars, tout le monde pourra faire un don du sang sur un même pied d’égalité, sans que l’orientation sexuelle ne soit mentionnée.
Profitons-en pour faire le point sur cet acte qui sauve des vies.
Pourquoi faut-il donner son sang ? • Romain, 26 ans
Le sang est un liquide biologique qui n’est pas remplaçable par une autre substance. Il n’est pas possible, du moins pas encore, de recréer du sang dans sa totalité, du fait de sa composition riche et complexe. Permettant de transporter l’oxygène à tout l’organisme, il est donc indispensable à la vie, et indispensable pour soigner certains malades.
Certaines personnes ont besoin de recevoir un groupe sanguin particulier. Les groupes existants sont A, B, O et AB. On appelle donneurs universels les personnes ayant comme groupe sanguin O-, ils peuvent, en effet, donner à tout le monde. Cependant, les personnes de groupe O ne peuvent recevoir que du sang du même groupe. Les receveurs universels, eux, sont du groupe AB+ et peuvent recevoir de tous les groupes. Il est donc important de donner son sang pour que les stocks de sang soient assez diversifiés.
Comment savoir si je peux donner mon sang ? • Julie, 32 ans
Pour pouvoir donner son sang, il faut être majeur, avoir moins de 70 ans, et peser au moins 50 kg. Ce sont les prérequis de base. À cela, s’ajoutent des règles afin de garantir la sécurité des donneurs et des receveurs. De plus, les femmes peuvent donner leur sang jusqu’à quatre fois en 12 mois et les hommes jusqu’à six fois. Il existe des contre-indications au don, que vous retrouverez dans l’encadré dédié.
Comment se déroule un don du sang ? • Roselyne, 58 ans
Tout d’abord, il faut se rendre dans un point de collecte : soit dans un centre de don de l’Établissement français du sang (EFS), soit dans un site de collecte mobile. Vous serez enregistrée à l’accueil, où vous devrez remplir un questionnaire. Puis, un médecin ou un infirmier s’entretiendra avec vous pour garantir la sécurité du don (pour vous et pour les receveurs) et vérifiera que vous êtes en mesure de donner votre sang.
Ensuite, place au prélèvement ! Une fois installé sur le dos, il dure une dizaine de minutes et est contrôlé par un infirmier. Le volume de sang prélevé dépend de votre poids.
Le meilleur est pour la fin : une collation est offerte une fois le don terminé, permettant de bien vous hydrater et de vous reposer pendant une vingtaine de minutes.
En tout, il faut compter 1 heure dans l’ensemble, et pas besoin de venir à jeun !
Combien de malades reçoivent du sang chaque année ? • Jean-Paul, 47 ans
Donner son sang bénéficie à 1 million de personnes chaque année, et les besoins ne diminuent pas ! Chaque jour, en France, 10 000 dons sont nécessaires.
Mais les dons du sang ne bénéficient pas uniquement aux “malades”, certaines situations d’urgence, comme les hémorragies, nécessitent une transfusion. Ils sont également utilisés dans la production de médicaments dits dérivés du sang, comme les immunoglobulines (pour le traitement de maladies infectieuses, de déficits immunitaires ou de maladies rares).
La crise du Covid-19 a affaibli les réserves en sang, alors n’hésitez pas à donner et à en parler à vos proches.
Quelle est la différence entre un don du sang et un don de plasma ? • Jules, 18 ans
Le plasma est une composante du sang, constitué en grande majorité par de l’eau, contenant des protéines indispensables aux transfusions sanguines.
En pratique, contrairement au don du sang qui peut se réaliser dans des points de collecte mobile, le don de plasma se fait uniquement sur rendez-vous et dans une maison de don. Ce type de don permet de recueillir une plus grande quantité de plasma que par un don classique.
Est-ce dangereux ? • Fatima, 33 ans
Absolument pas ! Le questionnaire et l’entretien avant le don sont aussi là pour protéger le donneur. Les effets secondaires sont très rares, et la collation et le repos une fois le don terminé permettent de refaire le plein d’énergie.
La piqûre cependant est obligatoire et ne fait pas plus mal qu’une prise de sang !
Pour plus d’informations : dondesang.efs.sante.fr
Enfin l’égalité : le don du sang n’est plus lié à l’orientation sexuelle
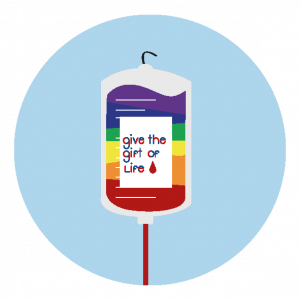 À partir du 16 mars 2022, les hommes homosexuels pourront donner leur sang selon les mêmes critères que les hétérosexuels. Cette avancée sociétale s’inscrit dans le prolongement de la Loi de bioéthique promulguée en août 2021. Avant cela, les homosexuels étaient interdits de dons de 1983 à 2016 (l’épidémie de VIH étant en cause), puis autorisés à condition d’être abstinents pendant au moins 1 an jusqu’en 2019 où le délai est passé à 4 mois.
À partir du 16 mars 2022, les hommes homosexuels pourront donner leur sang selon les mêmes critères que les hétérosexuels. Cette avancée sociétale s’inscrit dans le prolongement de la Loi de bioéthique promulguée en août 2021. Avant cela, les homosexuels étaient interdits de dons de 1983 à 2016 (l’épidémie de VIH étant en cause), puis autorisés à condition d’être abstinents pendant au moins 1 an jusqu’en 2019 où le délai est passé à 4 mois.
Qui ne peut pas donner son sang ?
- Les personnes prenant ou ayant pris certains médicaments, comme les antibiotiques (dans les 14 jours précédents), le Roaccutane®, des hormones de croissance avant 1989, ou ceux ayant été vaccinés dans le mois précédent.
- Les personnes ayant ou ayant eu les pathologies suivantes : paludisme (jusqu’à 3 ans après la dernière crise), infections actives transmissibles par le sang (VIH, syphilis, hépatites virales, etc.), antécédent de maladie à prions ou cancers.
- Les personnes ayant subi une intervention chirurgicale ou endoscopique dans les 4 derniers mois, ayant été greffés ou transfusés, ou ceux ayant eu un soin dentaire dans la semaine précédente.
- Les personnes tatouées ou percées il y a moins de 4 mois.
- Les personnes avec antécédent de drogues ou de dopage par voie intraveineuse ou intramusculaire.
- Les personnes ayant séjourné dans certains pays (voir liste complète sur le site de l’EFS) et celles ayant séjourné au Royaume-Uni entre 1980 et 1996 pendant plus de 1 an.
- Les personnes ayant eu des partenaires sexuels différents au cours des 4 derniers mois (les femmes homosexuelles ne sont pas concernées), et celles ayant des relations sexuelles à risque (voir liste complète sur le site de l’EFS).
Par Léna Pedon
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry