Lorsque l’amour et le désir s’effritent face au poids des années, le besoin de raviver la flamme se fait sentir. Quels sont les mécanismes derrière la détérioration des relations amoureuses ? Comment redonner vie à son couple ? Plongée dans les rouages de la mécanique du cœur.
Tout commence par un regard, un brasier s’allume et l’amour prend forme. Mais lorsque le temps vient souffler sur les braises, elles peuvent chanceler. La passion laisse place à la routine, le travail et les tracas du quotidien déchirent les liens tissés par les deux amants et, petit à petit, ils se perdent de vue.
« De nombreux facteurs peuvent favoriser la dégradation de la relation »
L’amour et le désir ne sont pas immuables, « de nombreux facteurs, très spécifiques à chaque couple, peuvent favoriser la dégradation de la relation, détaille Sébastien Garnero, psychologue clinicien, hypnothérapeute, psychothérapeute et sexologue. Lorsque les couples sont trop ritualisés, coincés dans des routines, cela peut nuire au maintien de l’amour ».
« C’est aussi le cas des conjoints qui ne se remettent pas en cause et ne prennent pas en compte l’autre », poursuit le psychologue, qui précise qu’il y a « aussi des personnalités, parfois pathologiques, qui peuvent déséquilibrer la relation dans le couple. Cette dynamique va pousser l’un des partenaires à jouer le rôle d’aidant, ce qui, sur le long terme, peut tuer le désir. Une forme de zapping émotionnel, amoureux ou sexuel, peut aussi s’installer et causer la perte du couple ».
Baisse de libido : un possible obstacle au désir
Les problématiques rencontrées par les couples peuvent aussi varier en fonction de leurs âges et de la place de la vie sexuelle dans leur relation. Ainsi, les fondations d’un couple asexuel ne sont pas liées au rapprochement des corps. Alors que, dans les relations où le sexe a une importance, la baisse de libido peut constituer un obstacle à surmonter. Une problématique qui peut concerner notamment les couples de seniors au moment de la ménopause chez les femmes et de l’andropause chez certains hommes (voir encadré).
« Le principal organe sexuel reste le cerveau »
Cependant, ces difficultés liées aux changements hormonaux « ne sont pas forcément aussi présentes chez tout le monde, sachant que le principal organe sexuel reste le cerveau, souligne Sébastien Garnero. Les personnes ayant un imaginaire érotique et conservant une activité sexuelle importante souffrent généralement moins des effets délétères des modifications hormonales sur leurs ébats ».
Le psychologue ajoute que « maintenir une bonne santé physique et psychique contribue aussi à l’épanouissement sexuel, quel que soit l’âge ».
Cultiver le désir pour maintenir la relation
Tout comme le bien-être, le désir a besoin d’être cultivé à tout moment de la relation. Il arrive que des couples ne ressentent plus d’attirance l’un envers l’autre à force de l’avoir mis de côté.
Le fait d’être stressé, de vivre une période de transition et de réorganisation de sa vie, comme le passage à la retraite, ou même le poids de croyances sociétales prétextant qu’à partir d’un certain âge, il n’est plus possible de ressentir d’attirance physique, peuvent favoriser la perte de désir et dégrader la relation amoureuse.
Retrouver le berceau de la discorde grâce au dialogue
Pour retisser le lien, Sébastien Garnero recommande de revenir à l’origine de la perte de désir et d’ouvrir la communication entre les partenaires de vie. « Grâce au dialogue, les amants pourront évoquer leurs attentes, leurs frustrations et leurs peurs. Ils pourront recréer, par ce biais, une complicité, une connexion émotionnelle, qui est souvent préalable à la réactivation du désir sexuel. Ensuite, il sera possible de redonner naissance à de l’intimité. Elle peut se traduire par une forme de tendresse, d’affection, par des câlins, qui vont, petit à petit, se transformer en sensualité », explique le psychologue.
« Toutes formes de médiations permettent de rétablir la connexion dans le couple »
Plus que les mots, les actes sont ce qui permet de redonner corps à la relation. Faire de nouvelles activités permettra au couple de se créer de nouveaux souvenirs et des moments de complicité.
« L’utilisation de toutes formes de médiations, qu’elles soient culturelles, sportives ou autres, permet de rétablir la connexion dans le couple. Parfois, dans les relations longue durée, certains se sont un peu trop éloignés, et ont l’impression d’être deux étrangers partageant le même lieu de vie. Ils sont passés du statut d’amants à celui de colocataires et doivent donc retrouver cette flamme, cette idéalisation, ce coup de cœur qu’ils ont eu l’un pour l’autre », conclut le psychologue. •
Ménopause et andropause : quels effets sur l’organisme ?
• La ménopause, qui se déclenche généralement entre 45 et 55 ans, est à l’origine d’une baisse des œstrogènes qui engendre généralement une sécheresse vaginale, pouvant provoquer des douleurs avant, pendant ou après les rapports sexuels. D’autres symptômes sont susceptibles d’apparaître, comme de la fatigue, de l’irritabilité, des douleurs articulaires et des bouffées de chaleur, qui peuvent réduire la libido.
• L’andropause, quant à elle, touche 20 % des hommes de plus de 60 ans. Elle vient d’une diminution progressive du taux de testostérone dans le sang. Plusieurs symptômes accompagnent ce trouble hormonal, avec notamment des dysfonctions érectiles, une baisse de la libido, un état dépressif et une réduction des capacités à réaliser des activités vigoureuses.
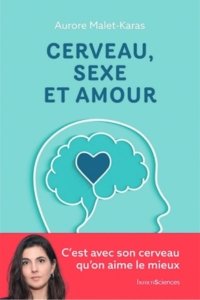 Cerveau, sexe et amour, par Aurore Malet-Karas.
Cerveau, sexe et amour, par Aurore Malet-Karas.
Collection
Quoi de neuf en sciences ?
264 pages, 21 €
Les réactions orchestrées par le cerveau amoureux
Lorsque l’on est amoureux, notre corps et notre cerveau sont le siège de nombreux bouleversements biochimiques. Si certaines molécules ont été surnommées, à tort, « hormone de l’amour », l’étude scientifique des mécanismes à l’origine de cet état s’avère, en réalité, plus délicate.
Pensées obsessionnelles, difficultés de concentration, accélération du rythme cardiaque quand on aperçoit l’être aimé… La période succédant au coup de foudre se caractérise par des changements comportementaux et physiologiques. « On est dans une espèce de rush. Cette anticipation est assez proche de celle que l’on ressent avant d’aller faire des manèges à sensations fortes », explique Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences cognitives et sexologue. Cette lune de miel s’accompagne — entre autres — de la libération d’adrénaline, de cortisol, impliqué dans le stress et l’énergie, et d’hormones stéroïdiennes qui guideront le désir sexuel.
Néanmoins, caractériser les processus neurobiologiques qui surviennent au moment de la rencontre amoureuse — et après — est une tâche loin d’être évidente, pour des raisons méthodologiques.
Il y a 20 ans de cela, une étude pionnière menée par Helen Fisher a tenté d’explorer la question biologique de l’amour. Elle consistait à présenter une photo de l’être aimé aux participants tout en surveillant les zones cérébrales activées. Les résultats, bien que peu robustes à l’époque, suggéraient l’implication d’un système cérébral dans les sentiments passionnels : le système dopaminergique. Selon la Dr Malet-Karas, ce dernier est également mobilisé dans les habitudes du couple, mais agirait aussi en cas d’alerte ! Pour signaler qu’un élément perturbe la routine. « Les moments qui procurent de l’inquiétude, parce qu’on ne les avait pas anticipés, permettent également de nous rappeler le lien qui existe avec notre partenaire, et à quel point on y tient. Le système nerveux est, heureusement, capable de s’ajuster, de s’adapter à la nouvelle situation », ajoute-t-elle.
Explorer les mécanismes neurologiques et psychologiques qui régissent nos comportements amoureux et sexuels, c’est la tâche à laquelle s’est attelée Aurore Malet-Karas dans son livre Cerveau, sexe et amour. « À la question : qu’est-ce que c’est d’être amoureux ? Et bien, en réalité, la science n’a pas exactement encore toutes les réponses », conclut la docteure.
Par Corentin Bell & Cléo Derwel
 Heart
Heart Haha
Haha Wow
Wow Yay
Yay Sad
Sad Angry
Angry



